Mon carnet de route. Campagne 1914-1919
Xavier Nicolle au 117ème Régiment d’Artillerie Lourde
Notes de guerre de Xavier Nicolle, Sergent aux 79ème, 113ème, 207ème Régiment d’Infanterie et Maréchal des Logis au 117ème Régiment d’Artillerie Lourde.
Cadre des O.P.G. caserne La Hire à Montauban.
En souvenir de Georges Marchand et de son épouse Renée, fille de Xavier Nicolle.
Petit carnet de 210 pages manuscrites (170 x 100 mm), sur ses campagnes entre le 30 juillet et le 21 novembre 1914. Sans doute mis au propre à partir du manuscrit originel, il est d’une écriture assurée, c’est un document exceptionnel de par la description de ce qu’il a vécu durant ces quatre mois. Ce qui en fait son grand intérêt historique, c’est qu’il comble la lacune du Journal de Marche et d’Opération (JMO) du 79ème RI, inexistant pour cette période de la Grande Guerre. En effet, le premier JMO conservé par les archives militaires commence le 23 novembre 1915, soit un an après la fin du récit de Xavier Nicolle.
Mobilisation
Nancy le 30 juillet 1914
Caserne du 79ème RI. 11h00 du soir. Tiens ! Une sonnerie de clairon, à cette heure, qu’est-ce que cela peut bien être. « Çà y est, c’est la Générale » dit un ancien, c’est la mobilisation. Depuis quelques jours en effet, on ne parle que de guerre, mais ce n’était pas possible que pareille chose se produise de nos jours, ce serait trop terrible.
« Tout le monde debout, et vivement ! » crie le caporal Besson, « et prenez votre collection de guerre ». Nous savons à présent ce qu’est une mobilisation, car depuis trois semaines, nous en avons fait assez de cet exercice. Nous prenons donc dans notre paquetage, les effets neufs qui doivent servir à faire campagne.
Le sergent de semaine passe en courant dans les chambres et s’assure que chacun a compris. Puis dans chaque escouade, des hommes de corvée se précipitent au magasin pour toucher les chaussures neuves, équipements et matériel de campement, enfin tout ce qui est nécessaire à l’homme pour partir en campagne.
La caserne, qui était encore endormie il y a cinq minutes, est maintenant transformée en une ruche très active, tout le monde court, chacun se presse, mais sans bruit et dans le calme le plus parfait. Il est environ 1heure du matin et dans deux heures nous devons être prêt à partir. Les cartouches sont retirées des poudrières et distribuées à raison de 120 par hommes, puis les paquets de pansements et plaques d’identité. Ces dernières choses font alors une légère impression lorsqu’on les reçoit. On n’ose pas encore croire à la guerre, ou plutôt on ne peut y croire, et pourtant ?
Nous sommes maintenant en tenue, habillés, équipés de neuf, les sacs sont montés. On entend alors la voix de l’adjudant : « la 11ème compagnie en bas ». Nous allons nous rassembler dans la cour, l’appel fait, on forme les faisceaux et nous remontons silencieusement dans nos chambres. En attendant l’ordre de partir, nous mettons tout en ordre, ce qui reste de notre paquetage est plié et mis en ballot, il en est ainsi fait des effets de drap, linge et chaussures. Le tout devra être envoyé au dépôt de Neufchâteau.
Tout est terminé, un dernier coup d’œil, car il ne faut rien omettre. Le Capitaine Ruze passe l’inspection et parait satisfait. Le calme et le silence se fait petit à petit, et par cette nuit tiède le 79ème Régiment est alors prêt à partir. En attendant, chacun se livre à ses pensées et rapidement on rédige quelques lettres, aux parents, aux amis, que beaucoup peut-être ne reverrons plus. Mais cette dernière idée ne nous atteint même pas.
Puis le jour se lève, et l’on ne part toujours pas, pourtant tout est prêt. Enfin, on a toujours le temps d’aller boire un verre à la cantine, on en a besoin car on n’a pas beaucoup reposé cette nuit. Nous voilà donc parti à plusieurs copains chez le père Jules, un brave cantinier, qui a une femme serviable et une fille de vingt ans, jolie et aimable pour le petit piou-piou. La conversation s’anime bientôt, et naturellement on parle de la prochaine bataille, chacun veut devenir un héros, et dès la première rencontre avec les allemands, chacun veut en descendre plusieurs. Nous avons confiance en nous et en nos chefs.
La journée se passe dans cette fièvre d’attente. Une foule de curieux se presse devant la porte du quartier, pour voir quoi ? Peut-être comment nous prenons la chose. Des parents voudraient embrasser leur fils avant de les laisser partir, mais il est défendu de laisser rentrer quelqu’un, ce serait une invasion. C’est ainsi que la journée se passe.
Tout à coup la foule s’écarte pour laisser un motocycliste arrivant à toute allure de la Division. C’est l’ordre de partir. Il est 7 heures du soir. Cette nouvelle est accueillie de tous par des hourras frénétiques. Vive la France ! Vive le 79ème ! C’est émotionnant. Rapidement on se rassemble, l’appel est fait. Il ne manque personne. Et le régiment franchit la porte du quartier, pendant que la musique joue un air entraînant et que la foule nous acclame. Pendant tout le parcourt pour sortir de Nancy. C’est un enthousiasme grandiose, pour un peu, nous serions portés en triomphe. Nous en étions émus et pas un de nous, je crois, n’aurait donné sa place. La mobilisation est faite, maintenant où allons-nous ? Vive la France.
31 juillet 1914
Les autres régiments de la garnison avaient fait comme nous la veille, ceux de Toul étaient déjà passés et se trouvaient dans les environs. Ils allaient prendre leur place sur la frontière et continuer les petits travaux de défense que nous avions commencés depuis 3 jours.
Mon bataillon, le 3ème, devait garder les ouvrages stratégiques jusqu’à l’arrivée des territoriaux. Ma compagnie va à Malzéville, des postes sont installés auprès des ponts, carrefours. Mon escouade garde un pont du chemin de fer Nancy-Paris. C’est alors sur la ligne un défilé continu de trains qui emmènent les réservistes en grande hâte à leur garnison respective.
Pendant deux jours nous assurons la garde de ce pont. Nous ne sommes pas malheureux, des civils nous apportent de quoi faire la soupe et aussi à boire. Nous ne regrettons rien de la mobilisation.
2 août 1914
Dès le matin nous arrivent les réservistes, ils sont aussitôt affectés dans les escouades, les nouveaux gradés font connaissance avec leurs hommes. Ces derniers arrivés ne voient pas l’avenir si gai que nous autres, la plupart ont quitté femme et enfant, mais quand même ils sont bien décidés d’y aller quand il faudra.
Vers 3 heures du soir, nous sommes remplacés à notre poste par les territoriaux. Ils sont plutôt bizarres ces vieux soldats à écussons blancs, habillés dans des effets trop courts pour les uns, trop larges pour les autres, pas de jambière. Mais cela ne les empêchera pas de faire leur service convenablement. Les consignes sont passées rapidement, le lieutenant de Béchillon emmène ma section, la 1ère, puis plus loin nous retrouvons le reste de la compagnie qui prend notre suite sous le commandement du lieutenant.
De nouveau, nous traversons Nancy, qui est devenue plus calme que 3 jours avant et nous sortons par le côté Est, prenant la direction de la frontière.
Notre Colonel, le Colonel Aimé, passe près de nous en auto et nous annonce que déjà des détachements ennemis sont passés en France, pourtant la guerre n’est pas encore déclarée.
Ce jour-là, nous allons jusqu’à Agincourt, où nous cantonnons, nous y trouvons le reste du régiment, sauf une compagnie qui est placée en avant-garde.
Je rencontre ce soir, Charles Peultier, qui est au 8ème d’Artillerie, leurs pièces sont en batterie un peu plus loin, les hommes viennent coucher au pays. La nuit se passe sans incident.
3 août 1914
Ce matin, nous recevons des outils (pelles, bêches, pioches, scies etc.) des habitants et nous partons creuser des tranchées. Pendant deux jours, nous travaillons à faire des travaux de défense, car nous devons attendre les autres corps d’armée avant d’aller plus loin.
4 août 1914
Toute la journée, nous travaillons avec le même entrain que la veille. À 4 heures du soir, le bruit se répand que les relations entre la France et l’Allemagne sont rompues, c’est donc la guerre.
Et bien tant mieux, nous sommes fixés à présent, jusqu’alors on avait douté, tout s’arrangerait peut-être, tout ce dérangement aurait été inutile. Maintenant c’est la guerre. Eh ! bien nous irons et de bon cœur.
5 août 1914
Nous quittons Agincourt dans la soirée et allons occuper Dommartin sous Amance.
Nous rencontrons là un Général qui nous parait très familier. « Pensez-vous que nous en avons pour longtemps pour avoir les prussiens ? » lui demande t-on. « Non, dit-il, tout au plus un mois ». Ainsi nous avions confiance. À Dommartin nous construisons également des tranchées, faisons un peu d’exercice afin de remanier un peu les réservistes. Déjà on apprend que des patrouilles du 5ème Hussard ont fait des hulans prisonniers. Ces derniers ne sont pas très hardis devant les nôtres, parait-il.
6 août 1914
Mêmes travaux que les jours précédents. Ce matin-là, notre Commandant, le Commandant Salle, homme énergique et très sympathique à la fois, que nous aimons tous, fait rassembler son bataillon. Dans une brève allocution, en chef et en même temps qu’en père de famille, il nous explique la situation. La guerre n’est pas un jeu et nous devons la comprendre telle qu’elle est. Il nous demande de faire dès maintenant le sacrifice de notre vie, partout il nous conduira au chemin de l’honneur.
Avec un tel chef, notre confiance est sans limite et nous nous promettons tous de faire ce qu’il faudra.
Je fais ensuite connaissance d’un réserviste qui se trouve à mon escouade, Chapelier. C’est un alsacien, il a été élevé à Strasbourg et y a habité jusqu’à 22 ans. Ayant obtenus un sursit, il n’a pas fait son service militaire là-bas. Il aimait trop la France, n’ayant plus de parents, qu’une vieille tante à Strasbourg, au moment d’être obligé de servir l’Allemagne, il passa en France et vient de s’engager à Nancy, au 79ème. Il ne savait pas encore un mot de français, mais doué d’une intelligence rare, il apprit notre langue pendant le service militaire. Depuis il s’était marié à Nancy.
Je me suis pris d’une grande amitié pour ce soldat qui haïssait l’allemand et depuis nous ne nous quittons plus. J’avais aussi un autre camarade, Bertrand, qui était du Loiret, de Beaulieu sur Loire. Un brave garçon, doué d’un grand cœur. Bertrand aimait aussi Chapelier. Ce jour là alors, nous nous étions promis tous trois de ne plus nous quitter, et nous nous aiderions à supporter les fatigues et souffrances à venir.
7 août 1914
Nous quittons Dommartin au matin et nous nous rapprochons encore de la frontière, pendant cinq jours, nous naviguons à droite et à gauche, plaçant quelques fils de fer à la lisière de ce bois, creusant une tranchée sur cette crète.
Ces jours là, nous avons vu les premiers effets des canons ennemis tirant sur nos avions qui surveillaient au-delà de la frontière. Inutile de dire que le résultat était nul et que ces flocons blancs qui se détachaient en l’air, n’effrayaient pas nos aviateurs.
Tantôt, nous couchions dans des granges, tantôt à la belle étoile. Nous venions d’apprendre que les allemands étaient entrés dans Nomeny et ils y avaient déjà fait des cruautés.
13 août 1914
Par une chaleur terrible, nous allons à Cercueil Buissoncourt, après une marche pénible. Nous sommes à une quinzaine de kilomètres de la frontière. Notre Corps d’Armée se resserre et vient prendre sa place pour la bataille, les régiments du Centre et du Midi étant arrivés à nos côtés.
A Buissoncourt nous pouvons enfin nous remettre un peu de nos grandes fatigues, nous nettoyer, graisser les armes. Le sergent-major achète un tonneau de vin et chaque homme de la compagnie en touche deux litres. C’est là que j’apprends que la 11ème compagnie avait 266 hommes à son effectif.
J’ai la joie de rencontrer Eloi Guénin, qui est de chez moi, il est accouru lui aussi à la mobilisation. Il est à la 3ème compagnie.
Le soir, le lieutenant de Béchillon, qui est mon chef de section, vient nous voir et nous apprend que c’est demain la première bataille que nous allons livrer. Il a confiance que çà réussira, les plans ont été bien étudiés. Et puis nous ne sommes pas seuls, tout autour sont massés des régiments qui marcheront comme nous. Nous allons donc enfin connaître la guerre dans quelques heures. Notre espoir ne baisse pas, et nous nous endormons bien vite, afin d’être « dispos » à la première heure.
Ma première bataille.
Réchicourt. 14 août 1914
A 2 heures du matin, le clairon sonne le réveil. En deux tours de mains, les sacs sont montés, pendant que des camarades allument le feu pour faire chauffer le jus.
Nous avons touché des vivres pour la journée, rapidement on casse un peu la croûte. Une heure après, le régiment se rassemble et nous sortons du village de Buissoncourt. Cette fois nous allons à la rencontre de l’ennemi que nous devons aborder pour tout de bon.
Nous suivons d’abord un chemin dont les arbres qui le bordent ont été abattus par le génie, afin d’enlever ce qui pourrait servir de point de repère pour l’ennemi. Au lever du jour, nous nous arrêtons dans une vaste plaine près de Serre à l’abri d’une forêt. Il y a déjà des troupes qui attendent, sac à terre, puis d’autres arrivent encore. Il y en a de toutes armes, infanterie, artillerie, cavalerie. Quelques uns de nos avions surveillent le ciel. Cette masse d’hommes offre un aspect réellement impressionnant.
Les officiers sont appelés devant le Colonel qui va dicter ses ordres comme pour une manœuvre importante, pendant que des petits postes sont placés en avant du bois, « Je fais partie de ceux-ci ».
Abrités par des petits arbustes, devant nous le soleil éclaire d’immenses vallées et plateaux que nous fouillons du regard. Rien qui indique la présence de l’ennemi. Certainement nous en sommes encore éloignés. Puis la cavalerie doit faire des patrouilles devant nous, nous serons donc avertis à temps, mais il faut toujours être sur ses gardes.
Enfin les ordres sont donnés car voici la tête du régiment, nous reprenons place dans nos sections. Nous marchons alors en silence, les sections étant espacées en largeur et en profondeur.
Profitant de tous les couverts, nous descendons les pentes, suivons les défilés, puis nous gravissons encore un plateau. A ce moment, la 9ème compagnie doit prendre une mauvaise direction, car voilà le commandant Salles qui passe au galop avec son cheval et fait de grands gestes.
Plus nous avançons, plus nous sentons que l’heure grave approche. Mais on ne voit rien, on n’entend rien, le soleil nous accable de plus en plus.
Nous arrivons alors au sommet du plateau pendant que des sections vont déjà descendre de l’autre versant, devancées par quelques patrouilles.
Tout à coup, on entend des coups de feu et bientôt la fusillade devient plus intense. Je crois que ce sont les allemands qui se préparent à nous recevoir. Nous ne tardons pas a être vu nous aussi et voilà que les balles, les premières balles, nous sifflent aux oreilles. On dirait un bourdonnement d’abeilles, mais un peu plus aigu. Cela n’arrête en rien notre marche et nous découvrons tout à coup, Réchicourt, petit village français bordant la frontière. Les allemands y sont installés et nous tirent de partout, derrière les murs des jardins, les fenêtres des habitations.
Il faut alors modifier notre marche et avancer par bonds, en cherchant à envelopper le village. En courant, nous descendons la côte couverte de blés mûrs, puis l’on se couche pour envoyer quelques paquets de balles sur le village et l’on repart de nouveau. Nous atteignons alors les abords du pays, mais les coups de feu diminuent. Les premières maisons sont contournées, puis plus rien, l’ennemi paraît s’être retiré. Rapidement on fouille les maisons et les rues qui étaient barricadées à chaque extrémité, par des voitures, des charrues, des fils de fer entrelacés. Les habitants sortent enfin, petit à petit de l’intérieur de leur logement ou de leur cave où ils ne sont encore qu’à moitié rassurés, car les allemands leur ont fait des misères en enlevant une grande partie du bétail et menaçant le propriétaire qui faisait la moindre résistance.
Il ne faut pas perdre de temps mais poursuivre l’ennemi que l’on voit à quelques centaines de mètres fuyant rapidement dans la direction d’un bois. Nous mourons de soif, vivement je décroche le seau accroché à mon sac et bondis dans une maison, pendant que je pompe, une pauvre femme me raconte que les allemands lui ont enlevé ses moutons et sa vache. Je lui dis qu’on le leur fera payer et surtout qu’ils ne reviendront plus, puis je rejoins en courant mes camarades qui étaient heureux de pouvoir se mettre un peu d’eau sur les lèvres.
Pendant ce court combat qui avait duré une demi-heure, nous avions eu quelques blessés, je ne sais pas ce que l’ennemi avait récolté, mais nous en avions touchés, car nous avons vu plusieurs taches de sang dans l’herbe, ce qui a excité bien plus notre rage.
Cependant il ne fallait pas marcher jusqu’à la lisière du bois où nous venions de voir rentrer les fuyards, sans savoir sur qui nous allions tomber. Combien étaient-ils cachés sous les arbres ? Nous ne le savions pas.
Nous arrivons alors au sommet du plateau et nous faisons halte, donnant le temps aux troupes qui sont en réserve d’approcher jusqu’à nous. Ma section est toujours en tête, un camarade est envoyé un peu en avant pour surveiller un peu le terrain et éviter toute surprise.
Il allait être midi, notre première rencontre n’avait pas mal marché, les avant-gardes ennemies avaient été repoussées, nous venions de passer la frontière et nous foulions à présent du terrain qui avait été ravi à la France depuis 44 ans. Bref nous étions contents de nous.
Tout à coup, un sifflement, quelque chose que nous n’avions jamais entendu, puis un bruit terrible, une explosion en même temps qu’une épaisse fumée noire s’élève, un obus venait d’éclater à cent mètres de nous. Le premier obus, un 210 je crois, et qui était bien pour nous. Nous sommes repérés murmure-t-on de tous côtés. « Vite, en carapace » commande le lieutenant, c’est la position que l’infanterie prend quand elle est sous le feu de l’artillerie. Chacun se met à genoux, jambes écartées, sac sur le dos, et tête enfilée sous le corps qui est devant lui. Serrés les uns contre les autres, les sacs se trouvent ainsi rapprochés et mettent à l’abri les parties essentielles, mais cela ne peut préserver que des obus fusants.
Mais ce n’est pas fini, à peine avons-nous obéi au lieutenant que d’autres obus arrivent, et cette fois c’est par quatre qu’ils éclatent. Et plus le temps passe, plus ce feu terrible est nourri. Les artilleurs allemands ont l’air d’y en mettre.
Ces coups tombent à gauche, à droite, en avant, en arrière, sans discontinuer, mais les éclats nous sifflent près de nous ou viennent frapper sur nos sacs. Cette fois, c’est la guerre dans toute sa terreur, chacun voyait sa dernière heure sonnée, d’une seconde à l’autre, nous allions être réduits en bouillie par ces engins terribles contre lesquels l’homme ne peut lutter. Puis où nous étions, nous servions de cibles superbes, la plaine partout, sans pouvoir nous abriter. Sous ce feu d’enfer, il ne fallait pas penser à se déplacer, nous devions rester là et attendre. Aussi les minutes paraissent longues, les heures semblaient des siècles.
Nous n’avions pu demeurer longtemps en carapace sous ce soleil de plomb, la tête recouverte par les jambes et la capote du camarade, nous étouffions, puis qu’est-ce qu’un sac pouvait faire devant ces obus, c’était une fatigue inutile. Pourtant personne n’osait se plaindre, peur de décourager les camarades, mais dans le fond nous avions tout de même un peu peur. Moi comme les autres.
Notre brave commandant n’avait pas l’air de s’émotionner, il allait et venait au milieu des obus, tranquillement, rarement il se baissait si un obus passait près, cela nous remontait un peu de voir un tel homme. Il cherchait d’éclaircir la situation où l’ennemi avait l’air d’avoir le dessus. Les allemands, dans leur fuite, nous avaient attiré sur ce terrain bien connu d’eux et nous avaient reçu avec leur puissante artillerie.
Nos 75 étaient trop petits pour répondre à leurs grosses pièces, il ne fallait rien attendre d’eux.
Pourtant, vers 5 heures du soir, voilà que sur notre droite, des régiments émergent de la crête, ils avancent par sections et prennent la direction du bois où les allemands se sont retranchés. Ce sont des régiments du 15ème Corps. Mais bientôt, ils sont reçus à leur tour par l’artillerie ennemie, et comme nous, les obus viennent faucher leurs rangs sans pitié. Mais cela ne les arrêtent pas, ils avancent par bonds, se couchant lorsque arrive une rafale, pour repartir ensuite. À certains moments ils disparaissent dans la fumée, nous les croyons perdus. Ils arrivent enfin à se grouper dans un repli de terrain en avant du bois où ils vont se reformer.
Pendant ce temps, l’ennemi a ralenti un peu son feu sur nous, nous arrosant seulement par rafales pour nous maintenir sur place. Nous ne pouvons rien pour améliorer le sort de nos voisins de droite.
Vers 7 heures du soir, une vive fusillade se déclanche tout à coup, cela nous fait frémir. Ces régiments qui passaient la crête tout à l’heure, viennent de s’élancer dans le bois où les allemands blottis dans des tranchées, les reçoivent à bout portant. Alors, il a dû se passer des choses terribles et je crois que la prise de ce terrain coûta cher aux nôtres.
Puis petit à petit, les coups de feu diminuent, le silence se fait, car la nuit est arrivée. On s’organise aussitôt pour éviter toute surprise de l’ennemi, car après une pareille journée, ce calme nous inquiète à présent.
On entend alors le cri des blessés qui, se voyant seuls dans la nuit ont peur de ne pas être découverts par les brancardiers. Rien de plus lugubre que les plaintes de ces malheureux, dont quelques uns vont succomber à leur blessure, peut-être faute de soins immédiats. Mais on ne peut cependant les enlever tous à la fois, le service de santé, peu nombreux, à fort à faire.
Puis nous entendons la voix grave du commandant qui se fait entendre, il parle à notre capitaine au sujet du ravitaillement qui ne nous arrivera certainement pas ce soir.et pourtant nous aurions besoin de boire et de manger.
Il est décidé qu’une forte corvée, bien armée, ira explorer Bezange-la- Petite, petit village allemand à un kilomètre de nous. L’ennemi a dû l’évacuer dans la soirée, ainsi que quelques-uns de ses habitants, mais les français n’y ont pas encore pénétré. Sans faire de violence, ces hommes devront rapporter les victuailles nécessaires à la compagnie. Ces volontaires ne manquent pas et les voilà partis sous le commandement d’un sergent. J’aurais volontiers fait partie de cette mission, mais je suis commandé pour être sentinelle tout à l’heure.
Une heure se passe et voici nos lascars qui réapparaissent, les bras chargés de pots de beurre, des oies et quelques canards, plusieurs seaux d’eau et deux ou trois bidons de vin seulement. Déjà nous nous réjouissons de cette aubaine et les souffrances de la journée sont oubliées, ce n’est pas trop mal la guerre si nous en avons autant chaque soir, et à bon compte. Nous recevons chacun un quart d’eau que nous absorbons avidement, cela nous fait du bien.
Etienne, un fameux loustic, qui a fait partie des bataillons d’Afrique, et que revient avec ces provisions de Bezange nous raconte comment çà s’est passé. D’abord ils n’ont rencontré personne dans le pays, les habitants s’étaient enfermés chez eux. Des troupeaux d’oies erraient dans les rues, un bâton ou un fusil lancé dans le tas et voilà de quoi faire un rôti pour l’escouade, d’autres copains se hasardent dans une maison qui paraît abandonnée depuis notre approche et en sortent également avec des musettes remplies de choses intéressantes.
Tout se serait bien passé si une patrouille d’uhlans n’était pas passée par là, quelques coups de feu ont été échangés, et la petite troupe, ne voulant pas être harcelée davantage regagna nos lignes au plus vite.
Mais nous voulons nous régaler le plus tôt possible, car l’estomac commence à nous tirailler. Pendant que quelques uns allument le feu, les autres se mettent en devoir de plumer les volailles. Bientôt les plats sont placés sur la flamme et installés autour, nous attendons que ce soit à point.
Mais il y avait à peu près dix minutes que les feux étaient allumés que l’on entend crier « aux armes ». C’est la sentinelle qui m’avait remplacé qui venait d’apercevoir quelque chose de louche se glisser dans l’ombre. Puis quelques coups de fusil.
« Alerte ! », « tout le monde sac au dos » fait passer le capitaine, et voilà qu’au lieu de se garnir le ventre, il faut envoyer un coup de pied dans les plats, éteindre rapidement les feux et partir en avant, la baïonnette au bout du fusil. Nous nous portons rapidement sur la ligne des sentinelles, mais on ne voit plus rien. Une patrouille fouille aussitôt le terrain en avant sans plus de résultat. Sans doute un petit groupe ennemi était venu pour nous surprendre, et est reparti ne se sentant pas en force.
Mais il peut en revenir un plus grand nombre et toute la nuit, nous demeurons sur place, l’œil fixé en avant et l’arme prête à faire feu, pendant que chacun à notre tour, nous creusons un petit élément de tranchée.
Puis le brouillard obscurcit complètement l’horizon en même temps que la fatigue nous envahit de plus en plus et nous avons de grandes peines à nous tenir éveillé.
C’est ainsi que nous passons la nuit, sans dormir et le ventre creux.
15 août 1914
A la pointe du jour, avant que le brouillard se lève, nous nous reportons un peu à l’arrière, dans une vallée. Je suis envoyé avec quelques camarades à Réchicourt, où nous sommes passés hier, chercher de l’eau pour préparer le café pris sur une partie de nos vivres de réserve. Pendant notre parcours, nous rencontrons des pauvres blessés, couchés sur des chariots dans lesquels on a mis un peu de paille, il n’y a pas assez de voitures d’ambulance pour transporter ceux qui ne peuvent marcher et l’on est obligé de recourir à ces moyens de fortune. Puis au détour du chemin, derrière une haie, c’est une équipe de brancardiers qui creuse une fosse pour enterrer des morts, qui sont là, à côté, la face noircie ou déchiquetée. Cela nous fait de la peine à voir. Mais nous ne nous arrêtons pas car là-bas, les camarades attendent. Au bas du village nous trouvons une fontaine, nos seaux remplis, nous faisons rapidement le chemin en sens inverse.
À notre retour, les feux sont allumés et nous attendons patiemment notre ration en grignotant un biscuit retiré du sac.
Maintenant le jour est venu, le soleil nous éclaire déjà. Les ordres arrivent au commandant. Sac au dos et nous reprenons la marche en avant. Nous contournons la position où nous avions été si malmenés hier et nous tombons sur Bezange-la-Petite que nous traversons. Les habitants pour la plupart n’ont pas l’air sympathique, mais nous n’avons rien à faire avec eux. Nous sortons du pays, passant près du cimetière, puis nous sautons dans la plaine en traversant encore un verger entouré d’une haie. Nous allions continuer notre marche, quand tout à coup nous croyons apercevoir à une petite distance des casques à pointe se dissimulant derrière des gerbes de blé. Nous ne devons pas nous engager sur ce terrain sans connaître ce que nous avons en avant, mais nous restons masqués derrière la haie pendant que quelques volontaires explorent les environs. Les compagnies de droite et de gauche font comme nous, puis voici un pli du colonel disant de rester sur place jusqu’à nouvel ordre.
Au loin devant nous, une suite de plateaux occupés par l’ennemi. Ce sont d’importantes positions d’où il lui est facile de découvrir tous nos mouvements. Je crois que nous sommes encore dans une mauvaise situation.
Nous n’attendons pas longtemps avant d’être fixés, car voilà une salve d’obus qui éclatent en avant de nous, les éclats viennent briser des branches aux arbres qui nous environnent. Puis le tir s’allonge et comme hier nous sommes en plein sous le feu de l’artillerie. Cette fois encore nous gardons notre sac sur la tête, mais sans nous mettre en carapace, seulement, à chaque fois qu’un obus passe trop près, par instinct nous nous enfonçons dans la haie sans seulement prendre garde si nous nous piquons, l’émotion nous fait perdre la tête.
Puis la voix de notre 75 se fait entendre, mais il n’existe pas sous l’artillerie adverse. Souvent nos batteries se trouvant aussitôt repérées sont obligées de changer de place.
Le temps passe lentement sous ce feu d’enfer, nous rageons de recevoir les atouts sans pouvoir nous défendre. L’ennemi est quelque part, sur de superbes positions, il nous observe et nous tient en respect, faisant des victimes dans nos rangs, mais nous, nus ne découvrons pas nos adversaires.
Plusieurs compagnies occupant Bezange depuis quelques heures profitent d’une légère accalmie pour essayer de se porter en avant. Elles n’ont pas encore quitté le village qu’une grêle d’obus s’abat sur elles, faisant des vides énormes dans leurs rangs.
Ceci paraît douteux car nos soldats suivant un chemin creux étaient sûrement invisibles depuis les positions ennemies. Il faut donc que quelqu’un, derrière nous ait signalé la présence de nos troupes. En même temps, ces dernières sont obligées de battre en retraite et revenir à leur point de départ. Le village est aussitôt fouillé et peu de temps après, on découvre un téléphone dissimilé dans la maison de l’instituteur qui est arrêté aussitôt. Celui-ci signalait aux allemands tout ce qui se passait chez nous et pas un de nos mouvements ne leur échappait.
Les obus rappliquent de nouveau sur nous. Une batterie de 75 passe au galop à quelques cent mètres et va chercher une position qui sera peut-être tenable, derrière une crête à notre droite. Au moment où nos artilleurs allaient se lancer dans une petite vallée, voilà que les marmites arrivent sur eux comme une pluie, tuant en une seconde plusieurs hommes et chevaux. Plusieurs pièces peuvent passer au travers des éclats, mais une autre plus malheureuse, à plusieurs attelages démontés. Alors à nos yeux s’offre un spectacle terrible. Pendant que les obus tombent sans cesse, les conducteurs sont obligés de dételer les chevaux morts, et les servants, demeurés sur leur siège se voient écrasés d’une seconde à l’autre. Il est peut-être 7 heures du soir. D’autres batteries viennent de réussir de se mettre en action, et voilà que nos pièces se mettent à cracher tout ce qu’elles peuvent.
Un lieutenant d’artillerie vient de ramasser une fusée d’obus ennemie et peut lire la distance où se trouve la batterie qui nous tire dessus.
C’est sur un plateau en avant de nous que se trouvent les canons adverses. Mais voilà nos obus font du bon travail, sur les hauteurs qu’occupe l’ennemi, ce n’est plus que fumée, puis plusieurs flammes s’élèvent, ce sont des dépôts d’obus qui sautent, détruisant plusieurs canons et hommes et surtout semant la panique à nos adversaires.
Pendant une demi-heure, nos canons crachent la mort et imposent le silence aux allemands.
Alors nous commençons à respirer plus librement. La journée a été très dure, mais finalement nous sommes les maîtres. La nuit s’approche et le combat cesse petit à petit. Le 2ème bataillon prend les avant-gardes et nous, nous rentrons à Bezange où nous passerons la nuit. Quelques maisons ont été un peu ébréchées par le bombardement, mais je ne crois pas qu’il y ait eu des victimes parmi la population. Nous n’avions rien mangé pendant la journée, comme ce soir non plus le ravitaillement ne nous est pas arrivé, on réquisitionne des vivres dans le pays. Ma compagnie reçoit ainsi 2 moutons et des pommes de terre.
La pluie se met à tomber et nous allons nous coucher car nous sommes fatigués. Bientôt nous nous endormons et cette fois nous ne sommes pas dérangés pendant le reste de la nuit.
16 août 1914
Il va faire jour bientôt, rapidement nous nous éveillons. Il n’y a pas de café ce matin mais nous recevons en place une petite ration d’eau de vie. Les compagnies se rassemblent et nous sortons bientôt du pays. La pluie a cessé de tomber, mais les chemins sont détrempés. Nous passons auprès du 2ème bataillon qui est resté toute cette nuit dehors, en avant-garde.
Nous sommes résolus de marcher en avant. Nous traversons un terrain labouré par les obus et de temps en temps, c’est un soldat français, mort, étendu sur la terre. L’ennemi semble avoir abandonné ses positions d’hier, car autrement, il ne nous laisserait pas avancer si librement, ou alors il nous tendrait un piège, il faut être prudent.
Nous arrivons devant un village, rien ne signale la présence de l’ennemi cependant nous nous arrêtons un instant pendant qu’une patrouille part en avant. Il n’y a personne de signalé, nous avançons à notre tour et nous traversons le pays.
Devant leur maison, des femmes, des enfants, des vieillards, nous regardent passer. Nous pensions qu’ils étaient heureux de voir arriver les soldats français, venant les délivrer de l’Allemagne, nous leur lancions quelques mots aimables, mais tout à coup leur regard semble dire le contraire. La plupart sont bien allemands et dorénavant, nous devrons nous méfier de cette race.
Nous dépassons le village et gagnons un terrain un peu plus loin. Plus de trace de l’ennemi, partout c’est le silence, on croirait qu’il a évacué toute la région. Nous creusons une tranchée avec nos outils portatifs, puis quelques camarades s’en retournent au pays acheter quelques provisions, il est midi et nous n’avons rien à manger. J’ai appris dans la soirée que des copains étaient rentrés dans la mairie du pays, avaient brisé la statue de Guillaume installée sur un socle et déchiré le drapeau allemand.
Puis nous avançons encore pour nous arrêter plus loin. Là encore nous creusons quelques tranchées pendant que des patrouilles de cavalerie sont lancées en avant. Aucun allemand de signaler, nous pouvons avancer. Nous traversons la route de Metz et nous prenons un chemin conduisant à Lay, Donnelay, que nous traversons ensuite.
Nous dépassons le 1er bataillon et je vois Canel de Xirocourt, mais je ne peux pas m’arrêter longtemps. Les téléphonistes du régiment réparent la ligne qui a été probablement coupée par l’ennemi lors de sa retraite. Nous traversons encore un village puis nous nous dirigeons sur une ferme à quelques kilomètres. Il va faire nuit, la pluie commence à tomber, les chemins sont détrempés, nous avançons péniblement. Des avant-gardes et petits postes sont installés mais mon bataillon est logé dans la ferme. Nous sommes mal logés, entassés les uns sur les autres, mais nous dormons quand même, la fatigue est trop grande.
17 août 1914
La pluie n’a pas cessé de tomber durant la nuit et ce matin, un épais brouillard nous environne. Le café est bientôt préparé et nous nous mettons en route. Nous gravissons alors la position sur laquelle pendant 2 jours, les allemands s’étaient solidement retranchés, mais avaient pris la fuite sous le feu de notre artillerie. Alors, c’est un terrain complètement retourné par les obus qui s’offre à nos yeux, puis des armes brisées et équipements qui gisent pêle-mêle, des obus abandonnés, un canon et plusieurs caissons brisés qui ont été abandonnés. Cela nous fait plaisir de constater la défaite de l’ennemi et nous sommes convaincus de notre force à présent que nous avons délogé nos adversaires d’une pareille position, surtout en voyant une série de tranchée solidement organisées.
On nous laisse admirer à notre aise notre conquête pendant une heure, puis nous reprenons la direction de l’Est, à la poursuite de notre ennemi.
Pendant plusieurs jours nous allons marcher sans rencontrer de résistance, seulement quelques combats de nos avant-gardes avec les arrières de l’ennemi.
19 août 1914 Bataille de Morhange
Depuis deux jours nous traversons des régions superbes, tous ces pays que nous parcourons vont devenir français et à chaque fois qu’un village est dépassé, on peut voir en haut du clocher, flotter le drapeau tricolore. L’ennemi ne s’est pas senti suffisamment en force, car nous avons de la peine à le suivre tellement sa retraite est précipitée.
Nous nous sommes mis en route de bonne heure ce matin. À la première halte, les commandants de compagnie rassemblent leurs hommes pour leur lire une note du général. « L’armée allemande, que nous combattons, a été mise en déroute par deux de nos divisions de cavalerie, nous allons nous mettre à sa poursuite et achever de l’anéantir. Notre tâche sera peut-être dure, car l’ennemi est encore capable de résister, mais notre ardeur aura le dessus. Une grande bataille se prépare, je compte sur vous. »
Et l’on peut, en effet, que compter sur nous car nous allons en mettre.
Nous suivons la route encore quelques kilomètres puis nous nous engageons à droite dans la plaine puis dans une forêt, nous redevenons avant-garde et c’est à nous d’ouvrir l’œil. Le
colonel Aimé marche derrière moi étudiant la région sur sa carte. Une batterie d’artillerie nous suit de près.
La forêt est traversée sans avoir rien rencontré et un village se découvre un peu plus loin. Est-il occupé ? Nous nous en approchons prudemment, nous sommes obligés de traverser une petite rivière, ayant de l’eau jusqu’à la ceinture. Le village est libre, nous le traversons. Puis, je suis envoyé en patrouille pour explorer une ferme un peu plus loin. Là non plus il n’y a pas d’ennemi, mais il ne doit pas être loin car les habitants paraissent inquiets et ne savent s’ils doivent répondre à nos questions. Un vieillard a sans doute peur que nous lui fassions du mal, car en nous voyant arriver il nous offre du tabac.
Nous nous portons jusque sur une crête et en attendant que les réserves s’approchent, nous préparons hâtivement un petit repas, il est 1 heure du soir et nous n’avons rien mangé depuis notre départ ce matin.
Tout à coup, on entend des coups de feu dans les environs, ce sont nos patrouilles qui tombent sur l’ennemi, il est donc là et comment va-t-il résister.
Une auto arrive à toute vitesse dans notre direction puis s’arrête à notre hauteur. Le Général Balfourier[1] Commandant le 20ème Corps en descend suivi de plusieurs officiers d’état major. Lestement le général se porte au point culminant de la crête et avec sa jumelle, observe le terrain en avant sans se soucier des balles qui sifflent autour de lui. Son observation terminée, il rejoint l’auto qui disparait bientôt à nos yeux. Il était temps car voici que le bombardement commence. L’ennemi sait que nous sommes là et jusqu’à la nuit nous sommes sous les obus, sans aucun abri. Une batterie de 75 est venue s’installer auprès de nous, ce qui fait que notre position est maintenant intenable. Nous changeons de place plusieurs fois sans jamais pouvoir échapper au feu de l’ennemi. Désespéré, plusieurs camarades se couvrent d’une gerbe de blé traînant par là, mais c’est insuffisant pour être abrité des éclats et bientôt plusieurs d’entre nous tombent, morts ou blessés. Pendant toute la soirée nous demeurons sous le feu de l’artillerie ennemie et ce n’est qu’une fois la nuit venue que nous pouvons reprendre haleine, nous estimant heureux de l’avoir échappé.
Dès le soleil couché, nous nous portons à la lisière d’un petit bois où nous devons creuser hâtivement quelques tranchées. Je suis envoyé au pays le plus proche, chercher de l’eau.
Nous arrivons dans le pays mais au lieu de nous laisser rentrer dans une grange où nous pourrions au moins nous reposer, on nous laisse tombant de fatigue et de sommeil, plus d’une heure au milieu de la route. Un Général est là discutant avec notre commandant, peut-être sommes-nous dans une mauvaise situation et que l’on va nous conduire encore plus loin. Enfin on nous conduit dans notre cantonnement, avec défense de se déséquiper, le sac et le fusil à sa portée. Bientôt nous nous endormons, nous n’en pouvons plus.
20 août 1914
Nous sommes debout de bon matin, car le ravitaillement en vivre nous arrive. Peut-être que pendant la journée nous n’aurons pas le temps de préparer à manger, nous devons profiter de ce calme pour faire la soupe. Aussitôt le jus avalé, nous préparons le diner, mais il faut plusieurs heures avant que ce soit cuit. Pendant ce temps, on se débarbouille et un petit nettoyage au fusil, il faut en avoir soin.
Il est peut-être 7 heures du matin, on entend déjà des coups de fusil et de canon. Puis tout à coup d’en haut de la rue, on entend de fortes clameurs, « à mort ! Tuez-les ! ». C’est un détachement de prisonniers qui apparait, poursuivis par les cris d’indignation des nôtres. Voici environ 60 à 80 casques à pointe qui ont été pris dans la nuit par le bataillon du Commandant Pernot[2] du 26ème RI.
Les prisonniers sont conduits par des cavaliers commandés par le Sous-lieutenant Jean Tourtel[3], de Tantonville, qui est à l’état-major, puis en attendant leur interrogation, ils sont gardés dans une grange.
La soupe est bientôt prête et nous préparons déjà nos gamelles, une bonne odeur s’échappe de la marmite, nous allons pouvoir contenter notre appétit.
Mais un agent de liaison cycliste arrive au commandant du bataillon puis le coup de sifflet du capitaine, c’est le rassemblement, il faut partir sur le champ. Mais ! Et la soupe, il ne reste plus qu’à la manger, déjà on commence à la servir, il n’y en a pas pour longtemps et nous ne pouvons l’emporter ainsi. Tant pis, c’est la guerre, il n’y a pas de temps à perdre, on a peut-être besoin de nous là-bas. « Rassemblement ! » crie encore le capitaine qui s’impatiente. Alors il n’y a plus à hésiter et nous devons faire le sacrifice de la croûte de la journée. D’un geste de colère, le cuisinier envoie un violent coup de pied dans la marmite, faisant rouler dans la poussière légumes et viande. Rapidement les ustensiles de campement sont replacés tout brûlant sur les sacs, par précaution pour la journée, je ramasse un morceau de viande et en route, car le temps presse je crois. A présent le canon gronde violemment dans les environs, puis quelques obus passent au dessus de nos têtes. Nous voici hors du village et nous sommes obligés de gagner les champs, la route est encombrée de voitures de blessés se dirigeant vers l’arrière, puis en sens inverse, ce sont des caissons d’artillerie qui vont ravitailler les pièces.
A présent plus nous avançons, plus la canonnade et aussi la fusillade se font entendre. Nous arrivons à la ligne de chemin de fer de Bénestroff et nous la suivons, marchant vers le champ de bataille. Nous sommes probablement vus de l’ennemi, nous sommes arrosés d’obus de gros calibres, cependant nous avançons quand même, prenant simplement une petite distance entre chaque section. C’est alors un défilé continu de blessés que nous croisons, ceux qui peuvent marcher aident leurs camarades moins valides. Ils appartiennent tous à la 39ème Division. Toute la journée d’hier et toute cette nuit, ils se sont battus avec acharnement, se lançant peut-être 20 fois à l’assaut de l’ennemi, solidement retranché et appuyé par une très forte artillerie, sans pouvoir le faire reculer. A présent, ce sont les allemands qui s’élançaient sur les nôtres qui sont très affaiblis après ce qui s’est passé et même parait-il que nous cédons du terrain.
C’est donc pour cela que l’on nous emmène aussi rapidement. « Où allez-vous les copains ! Vous allez à la mort ! C’est terrible ce qui se passe plus loin ! », nous crient sur un ton de pitié plusieurs blessés. Nous le sentons en effet que nous allons vers la mort, mais il faut marcher et personne ne se plaint.
Je passe près d’un camarade à qui une balle a cassé le bras. Le malheureux n’a pas de pansement, je lui en arrange un de mon mieux, j’ai de l’alcool de menthe dans la poche, je lui en verse une goutte sur un morceau de sucre et je rejoins ma section.
Les obus nous arrivent maintenant par rafales, gênant beaucoup notre marche, nous obligeant souvent à nous précipiter dans le fossé bordant la voie ferrée, pour éviter les éclats. Nous passons près d’une maison de garde-barrière dans laquelle est installé un téléphone, un de nous d’un coup de crosse de fusil brise l’appareil, on ne sait pas à quoi cela peut servir.
Mais nous nous arrêtons bientôt, nous sommes maintenant sous les balles en plus des obus. Devant nous on se bas ferme, mais nous perdons peu à peu du terrain.
Nous sommes échelonnés en tirailleurs le long de la ligne, légèrement masqués par une haie. Nous ne devons plus bouger de là, une compagnie derrière nous creuse une petite tranchée.
Les heures s’écoulent lentement sous ce déluge de fer. Continuellement, des blessés reviennent de la ligne de feu, ne sachant trop où ils vont. Puis voici le commandant, il cause avec notre capitaine. Ils s’arrêtent à quelques mètres de nous et enfin le commandant déclare « Nous devons nous défendre ici et jusqu’au dernier s’il le faut ». Ces paroles nous jettent un froid dans le dos. Certainement ce brave commandant fera le sacrifice de sa vie, mais nous avant d’en faire autant cela demande à réfléchir. Eh bien ! Oui nous resterons nous aussi et jusqu’au dernier s’il le faut. L’ennemi avance toujours, on voit ses vagues qui inondent la plaine, quelques-unes de nos sections se défendent avec ardeur devant nous, mais n’arrive pas à retenir les flots de l’adversaire. Encore un instant et ce sera notre tour de taper dans le tas avec nos fusils.
Voici le général Ferry, commandant notre brigade, il est tout pensif, et sans se douter des balles qui l’effleurent se dirige vers notre commandant et ordonne de nous replier. Nous allons être enveloppés sur la gauche, un régiment de marsouins qui devrait être là pour nous soutenir n’arrive pas, notre position est intenable. Mais une retraite sous le feu de l’ennemi est une chose très difficile et il faut à tout prix qu’elle s’effectue en bon ordre ; il faut toute l’énergie des chefs et une parfaite discipline des hommes. Alors par petits paquets de 10 hommes et avec une distance entre chaque fraction, nous reprenons en suivant la ligne du chemin de fer, le trajet que nous avons fait ce matin.
Nous battons en retraite, la lutte étant devenue inférieure pour nous, mais nous pouvons nous féliciter de nous replier dans un ordre parfait. Nous rentrons dans un pays et les premiers détachements arrivés attendent les autres jusqu’à ce que tout le bataillon soit réuni. Nous profitons de ce court arrêt pour trouver quelque chose à nous mettre sous la dent et surtout pour boire. Je trouve seulement de la crème que j’avale ainsi, sans pain et un bidon de mauvais vin. Mais, plusieurs obus s’abattent sur le pays, nous partons toujours vers l’arrière.
Pendant tout ce combat, notre artillerie a été de beaucoup inférieure à celle de l’ennemi.
Nous marchons dans la direction de Vic, nos arrière-gardes font leur possible pour enrayer l’avance des allemands.
Nous passons auprès de la 10ème compagnie du 69ème RI qui construit une tranchée à la hâte. Mon frère René appartenait à cette compagnie autrefois, peut-être l’a-t-il rejoint à la mobilisation, je n’en ai pas eu de nouvelle. Je m’informe auprès de quelques réservistes et j’apprends que mon frère a suivi le dépôt à Troyes. Tant mieux, il ne connaîtra peut-être pas toutes les misères de la guerre. Jusqu’à la nuit, nous marchons, tantôt en suivant les chemins, tantôt à travers champs, sans trop savoir où nos chefs nous conduisent. Nous nous arrêtons auprès d’un village et là tout le régiment, ou plutôt ce qui reste, se rassemble. Le premier bataillon a perdu les 3/4 de son effectif.
Auprès de nous, une batterie de 120 long, tire sans arrêt, nous nous croyons forts en voyant de telles pièces. Mais nous repartons bientôt, par des routes encombrées de troupes de toutes armes.
Enfin, vers 10 heures du soir, complètement exténués, nous entrons dans un pays de moyenne importance, c’est Moyenvic. Nous devrons cantonner ici, mais pendant près d’une heure, nous devons attendre sur le bord de la route, pour laisser passage à de nombreux convois. Puis nous sommes conduits dans une grange, n’en pouvant plus. Pour comble de malheur, c’est ma section qui doit fournir la garde de police, le poste cependant reste dans le même cantonnement que la compagnie. Alors au lieu de pouvoir dormir tranquille sur la paille, il faudra passer 2 heures à prendre la faction, cela ne nous fait pas sourire. Notre estomac, qui n’a rien eu depuis le matin, réclame lui aussi. Heureusement il paraît que l’on va toucher des vivres, d’ailleurs voici le caporal d’ordinaire qui appelle les hommes de corvées. Ceux-ci y vont, non sans se plaindre, ayant été troublés dans leur sommeil. Ils ont peut-être 2 kilomètres à faire pour arriver aux voitures. Puis au moment de faire la distribution des vivres, voici un ordre du Colonel, remettant à plus tard la livraison et faisant partir les voitures rapidement vers l’arrière.
Que se passe-t-il, nous ne le savons exactement, mais nous nous en doutons. Sans doute que l’ennemi arrive, car on nous fait équiper et quitter le pays aussitôt, il est minuit environ.
Alors nous reprenons notre marche vers l’arrière, c’est pénible, et il faut faire des efforts surhumains pour ne pas tomber sur le chemin. Les routes sont encombrées de troupes à pied et d’artillerie. Rien de plus fatiguant et de plus triste que notre cortège, nous avançons comme des bêtes, sans rien dire, dans la nuit.
21 août 1914
C’est avec beaucoup de peine que nous sommes arrivés avant le jour sur une petite crête. Immédiatement il a fallut creuser une tranchée avec nos outils portatifs. Mais avec toute notre énergie et notre meilleure volonté, nous n’en pouvons d’avantage et nous nous endormons successivement sur la terre remuée.
Le brouillard du matin nous éveille, il fait jour, nous avons dormi pendant deux heures environ, mais nous sommes encore engourdis, les membres brisés. Cependant il ne faut pas demeurer inactif, il fait jour et nous devons toujours rester sur nos gardes, l’ennemi est peut-être tout près. Je suis envoyé dans un pays pour prendre de l’eau pour préparer un peu de jus. Avec 2 seaux je parcours peut-être 4 kilomètres, malgré la fatigue, mais les camarades attendent, et un quart de café fera rudement de bien quand on n’a pas autre chose.
Toutes les troupes sont à peu près passées et nous sommes à présent arrière-gardes. Nous marcherons à la même allure que les troupes qui nous précèdent, nous ne comptons que sur nous-même pour arrêter l’ennemi.
Nous partons à notre tour et toujours en nous rapprochant de la frontière. Obligé de rester en arrêt un peu plus loin, probablement parce que les routes sont encombrées, puis nous reprenons notre marche.
Deux cavaliers sont avec nous et surveillent les environs, afin de nous éviter de trop courir.
Vers 10 heures du matin nous repassons la frontière et nous traversons Arracourt. La population est inquiète et s’enfuit à l’approche des envahisseurs, emportant seulement le plus indispensable de leur mobilier, certains même dans la précipitation abandonnent tout.
Nous ne comprenons pas très bien pourquoi nous nous replions sans presque nous défendre, nous obéissons simplement au commandement qui voit mieux que nous la situation. Nous pensons que nous nous arrêterons quand nous serons arrivés à une position meilleure, et là les allemands ne passeront pas. Arracourt est dépassé, les chemins sont de plus en plus embarrassés. Ce sont des blessés entassés sur des voitures, que l’on dirige vers l’arrière. Des civils, chassent devant eux leur bétail. C’est vraiment triste de fuir ainsi en abandonnant tout à l’ennemi. Heureusement, nous avons la conviction que les choses changeront bientôt de face et nous reprendrons l’offensive regagnant tout ce terrain perdu.
Nous avançons péniblement, la fatigue est trop forte, puis nous avons faim et rien à manger. Des artilleurs qui ont été mieux ravitaillés en vivre que nous, nous donnent un peu de pain que nous nous partageons. Les plus traînards se font conduire sur les canons, d’autres s’appuient sur l’épaule d’un camarade. Il ne faut laisser personne derrière, car il serait bientôt entre les mains de l’ennemi. Chacun décuple son énergie pour suivre et aller avec les camarades. Vers midi nous passons près d’une ferme, nous prenons un peu d’eau et nous en emportons dans un seau pour faire du café, mais il faut aller jusqu’à la lisière d’un bois un peu plus loin.
Nous arrivons au bois, mais le capitaine croit plus sûr de nous conduire plus loin pour faire le jus, pour l’instant, il laisse faire une petite halte. Nous abandonnons sac et fusil, il fait chaud, nous pénétrons dans le bois pour avoir un peu d’ombre. Je n’en peux plus, et je m’affale au pied d’un arbre, au milieu des broussailles ……..
……….. Tout à coup je crois sortir d’un rêve, où suis-je, tout seul au milieu de ces arbres. Mais je me remets vite à la réalité, je m’étais endormi quand nous sommes venus ici faire une halte ? Ce silence me fait peur, où sont les camarades ? Dans quelle direction sont-ils partis ? Je me trouvais un peu à l’écart et les copains ne m’ont pas vu quand ils sont partis. Je regarde ma montre, elle marque 3 heures, j’ai dormi plus de 2 heures.
Mais tout à l’heure l’ennemi était sur nos pas. Il ne doit pas être loin à présent ; si j’allais tomber dans leurs mains ; si j’allais être prisonnier ? Rien que cette pensée me fait oublier que je suis fatigué.
Je saisis mon sac et mon fusil et je vais aller à la recherche de la compagnie. Mais encore une fois, où est-elle partie ? Nous ne savions même pas où nous allions, changeant de direction à chaque instant. N’importe, je ne dois rester là un instant de plus. Je sors du bois, personne dans les environs. Je vais marcher dans la direction de l’Ouest et me voilà parti, courant presque, à travers champs.
Je rencontre de temps en temps des paysans qui chargent du blé, je les interroge. Ils ont bien vu passer par là un groupe de soldats, très fatigués, mais ne peuvent me dire le numéro du régiment. Si c’était ma compagnie, je serais sur la bonne piste et les rejoindrais bientôt. J’arrive sur un plateau et observe au lion, je vois quelques traînards, s’échelonnant le long d’un sentier. Finalement dans un fossé, j’aperçois un soldat assis, il vient de se déchausser, il a les pieds en sang, c’est un homme de ma compagnie. Il ne peut plus aller plus loin, me dit-il et attend qu’une voiture vienne à passer, il se fera conduire, n’importe où. Enfin je suis sauvé, je suis sur la bonne piste. Le camarade me dit qu’il a abandonné la compagnie il y a une demi-heure, elle ne doit pas être très loin. Même que tout le régiment va se rassembler par là.
À la lisière d’un bois, je vois en effet une troupe en arrêt. C’est bien le 79ème. Comment ! C’est tout le régiment qui est là, mais il a fondu de moitié. Je retrouve ma compagnie, heureux de revoir les copains. Le ravitaillement que nous n’avions pas eu depuis 2 jours est là, on fait la distribution des vivres, et nous dévorons aussitôt notre demi-boule de pain avec une boite de conserve. Nous touchons aussi de la viande fraîche et des pommes de terre, mais nous n’avons plus de force et le courage d’aller chercher du bois qui les ferait cuire.
Nous nous étendons sur le sol, en tâtant nos membres et surtout les pieds endoloris.
Allons-nous demeurer là longtemps ? Nous sommes bientôt fixés. Un ordre arrive au Colonel. C’est deux divisions de cavalerie allemandes, qui, paraît-il, arrive dans notre direction. Ces cochons là ne nous lâcheront donc pas d’une semelle. On fait aussitôt partir les voitures à l’arrière et mon bataillon se forme en carré, baïonnette au canon, prêt à recevoir la cavalerie ennemie. Le 1er bataillon se met en route, puis le 2ème, ils prennent toujours la direction de l’arrière. Quand ils sont assez loin, nous nous disposons à notre tour à battre en retrait, l’ennemi ne vient pas, mais nous demeurons toujours sur nos gardes.
Nous passons dans une ferme près de Serre, à la nuit, nous traversons Haraucourt où le 69ème RI s’est arrêté. Vainement nous nous demandons jusqu’où nous marcherons. À un moment, mon chef de ½ section, le sergent Petitjean, ne peut plus suivre, malgré toute sa bonne volonté, il se voit forcé de rester au bord de la route, puis peu à peu d’autres soldats tombent à leur tour. Ils rejoindront comme ils pourront ? C’est vraiment triste à voir notre allure, nous allons tête baissée, en silence, dans la nuit.
Mais voici que le sergent Petitjean nous rejoint, ce brave sous officier n’a pas voulu qu’il soit dit qu’il nous abandonnait. Ses pieds étaient en sang tout à l’heure, ses chaussures le blessaient affreusement, il les a enlevées et c’est sur ses chaussettes qu’il fait à présent la route avec nous.
Que d’actes de courage il y a dans cette retraite, et qui resteront toujours inconnus. Je me félicite de pouvoir suivre la colonne, car moi aussi je fais tout mon possible pour ne pas rester en arrière.
À 2 heures du matin nous arrivons à Dombasle, près de Nancy, c’est là que nous nous arrêtons. Nous allons cantonner dans les dépôts des salines. Il était temps vraiment car pas un de nous n’était capable d’aller plus loin.
Nous n’avons pas de paille pour nous coucher, seulement le pavé en ciment. Je trouve quelques sacs vides que j’étends sur le pavé et je me laisse tomber, épuisé. Nous nous endormons difficilement, nous avons de la fièvre. Nous n’avons plus la force de penser, nous sommes comme des bêtes.
22 août 1914
Il est 8 heures du matin, nous n’avons pas beaucoup dormi, mais nous ne pouvons demeurer couchés plus longtemps. La dureté du pavé nous a brisé les reins. Deux camarades complaisants s’occupent pour préparer le café. Nous cherchons encore des vivres, puisque depuis quelques jours nous ne les avions pas reçues régulièrement. Nous nous disposons alors à faire une bonne soupe. Il n’y a pas encore longtemps que nous sommes en campagne, mais nous avons tous une triste figure. Pendant que la soupe se prépare, nous allons acheter quelques provisions dans le pays. Puis nous nous donnons un petit coup de nettoyage ainsi qu’à nos armes. Nous pensons demeurer à Dombasle environ 2 jours, il doit y avoir d’autres troupes en avant. Nous ne serons pas mal ici, et déjà nous oublions les souffrances passées.
Les camarades qui hier étaient restés en route nous rejoignent insensiblement. La soupe est prête, nous allons la manger et avec quel appétit. Mais voici qu’un ordre arrive. Dans un quart d’heure il faut être prêt à partir. Comment, mais on n’y pense pas, nous arrivons à peine et il faut remettre cela. Ah ! Mais non, c’est une fausse nouvelle ! Pas du tout. Bon gré ou mal gré, sans nous donner le temps d’achever le repas, il faut nous préparer à repartir.
Quelques-uns, notamment un parisien nommé Gauthier, râlent bien un peu, mais le capitaine arrive, on se tait. Puis nous prenons notre place dans le bataillon et en route.
À la sortie de Dombasle, nous passons devant des soldats d’un régiment du (Un espace blanc) qui sont devant leur cantonnement. Il y en a qui sont nu-tête, d’autre en béret, avec ou sans capote, plusieurs ont abandonné leurs armes. Il parait que ces hommes, qui, comme nous, ont pris part à la dernière bataille, devaient marcher avant nous, mais ils sont plus démoralisés que nous, ont refusé et nous sommes obligés de partir à leur place. Cela nous met la rage au cœur. Il n’est pas moins vrai que nous allons nous faire casser la figure pour les autres.
Maintenant, Dombasle est derrière nous, nous quittons la colonne de route, pour prendre par section une formation moins dense, puis nous arrivons au haut d’un plateau. Le bruit de la bataille redouble au fur et à mesure que nous avançons. Nous avons des troupes qui combattent en avant de nous, mais on sent qu’elles reculent.
Nous nous arrêtons sur une position d’où nous découvrons une jolie vallée, près d’Anthelupt et là nous creusons vivement une petite tranchée. Bientôt nous sommes découverts et nous voilà bombardés par l’artillerie ennemie. Notre situation n’est pas bien brillante, mais quand même nous demeurons sur place, nous avons pour nos fusils un joli champ de tir et il n’est plus temps de se déplacer, maintenant que tout le terrain est battu par les obus.
La pluie se met à tomber et peu à peu la nuit arrive, le feu de l’ennemi aussi diminue et cesse à son tour. Mais sur notre gauche voici que la fusillade se déclenche tout à coup, malgré l’obscurité. Les allemands cherchent à pénétrer dans Flainval, mais en sont rechassés par un bataillon du 37ème R.I. L’ennemi se venge alors en incendiant le pays et nous voyons ces lueurs sinistres en même temps que l’on entend les fortes clameurs poussées par nos soldats chassant à la baïonnette les envahisseurs. Devant nous, la situation reste calme. Seulement quelques balles qui sifflent à nos oreilles. Plusieurs patrouilles vont fouiller le terrain sans rien rencontrer.
Au milieu de la nuit nous sommes remplacés et nous allons un peu à l’arrière où nous pouvons faire un bouillon et nous nous couchons, à la belle étoile, pendant que veillent des sentinelles. Comme à l’habitude, c’est moi encore qui suis allé chercher de l’eau. J’ai été à Hudiviller où les allemands avaient allumé plusieurs incendies.
23 août 1914
Nous sommes réveillés avant le lever du jour et par un épais brouillard on nous conduit un peu en arrière. Tout le bataillon rentre sous un petit bois. Nous sommes ainsi dissimulés à la vue des avions et pour nous garantir un peu des obus dans le cas où le petit bois viendrait à être marmité, nous creusons de petit éléments de tranchées profondes.
Nous passons la journée sous ce feuillage sans être dérangés, les obus tombent dans les environs, mais nous sommes privilégiés.
À la nuit, nous sommes alertés. Nous quittons notre emplacement et allons occuper un plateau en avant de nous. Le calme se rétablit et nous attendons là le lever du jour.
24 août 1914
Nous sommes probablement remplacés, car dès le matin, nous sommes conduits à l’arrière. Nous sommes exténués, nous marchons péniblement, courbés sous nos sacs. Nous arrivons à Coyviller vers 10 heures et nous y sommes cantonnés. Nous touchons les vivres et aussitôt nous faisons notre soupe. Cela fait, nous nous étendons sur la paille et nous ne tardons pas à nous endormir.
Nous passons la nuit et la journée du 24 août dans ce pays. J’en profite pour aller à la 3ème compagnie demander des nouvelles d’Eloi Guénin et apprend qu’il est disparu.
25 août 1914
Au soir, notre bataillon, désigné d’avant-garde pour le régiment, va loger dans une vaste ferme à 2 kilomètres. Nous y passons une nuit tranquille, quoi que passablement entassés pour dormir dans un grenier.
26 août 1914
En me levant ce matin là, je fais la connaissance d’un voisin de chez moi. Un nommé Etre, dit Michel, il est de Benney. Il est à la 2ème section de ma compagnie. Vers 2 heures du soir, nous quittons la ferme, nos 75 se font entendre, et au loin, grondent les grosses pièces ennemies. Un combat important est engagé. Les allemands tentent de franchir la Meurthe sans pouvoir y réussir. Nous avions fait sauter les ponts et l’ennemi essaye d’en construire d’autres, mais à chaque fois ils sont démolis par les obus.
Nous avons assez reculé parait-il, et nous devons garder nos positions coûte que coûte, malgré l’effort considérable des allemands qui emmènent des renforts importants. Nous traversons Rosières aux Salines, arrosée par la Meurthe. Le génie avait fait sauter le pont il y a quelques jours lors de notre retraite. En ce moment il en reconstruit un en bois à la hâte. En attendant que le pont soit construit, on a disposé dans la rivière, qui cependant est large, une ligne de voitures[4] attachées les unes aux autres et recouvertes de quelques planches. Les uns après les autres, nous traversons la rivière sur cette passerelle de fortune. Une fois de l’autre côté, nous attendons que tout le régiment soit passé, mais il faut longtemps. Nous avons mis sac à terre et attendons les ordres. La journée a été chaude et nous avons soif. Plusieurs camarades sont allés chercher du vin et m’invitent à boire. Comme je ne veux pas être redevable et profitant de l’occasion qu’il y a un débit de boissons dans les environs, je vais faire remplir à nouveau plusieurs bidons qui naturellement sont bus aussitôt. Mais je crois que plus on boit, plus on a soif et sur l’avis de tous, une nouvelle tournée ne ferait pas de mal. Lagnieu, un bon type de l’escouade, repart au café acheter d’autres bidons de vin. Mais il n’en reste plus, il n’y a plus que de l’eau de vie. Le commissionnaire en prend deux litres. Nous en partageons un séance tenante, gardant l’autre pour le lendemain matin. Mais toute cette boisson mélangée commence à nous travailler, surtout qu’ayant été mal nourris depuis quelques temps, notre estomac est malade. Je ne sais pas l’effet que cela a fait à mes camarades, mais pour ma part, j’en avais plus que suffisamment. La tête commença à me tourner, puis parait-il, je me suis mis à chanter. Les obus tombaient dans les environs mais je n’avais plus peur de rien. Finalement je me suis endormis. Peu de temps après je suis secoué par un camarade. Le régiment s’en va. Je ne suis pas bien fort sur mes jambes. Un copain me porte mon sac, un autre le fusil, et le bras d’un voisin passe sous le mien pour m’aider à marcher. Je m’étais enivré sans m’en douter et pour la première fois de ma vie.
Heureusement, nous retournions à Rosières, qui n’était pas éloigné. Et nous sommes passés sur le pont en bois que venait de terminer le géni.
Nous sommes conduits à la station des haras pour y passer la nuit. Je dors très mal, sur le pavé d’une écurie, avec le sac comme oreiller.
27 août 1914
À la première heure du jour, nous quittons notre cantonnement, pour reprendre la marche en avant. Je me ressens encore de mon malaise de la veille, j’ai la tête lourde, les membres las, et la gorge, je ne peux rien boire car tout me dégoutte. Malgré cela je suis mes camarades. Dans les environs, le canon se fait déjà entendre. Après avoir cheminé pendant un certain temps, nous arrivons à Flainval qui a un peu souffert du bombardement de ces derniers jours. Nous nous arrêtons environ une demi-heure à la sortie de ce pays. Pendant ce temps, Etienne, le type débrouillard est allé acheter quelques bouteilles de vin bouché. Je lui en achète une pensant que cela va me faire du bien, mais c’est inutile, je n’en peux avaler une goutte, décidément cela ne va pas.
Puis les ordres arrivent, nous allons repartir. Les officiers nous préviennent que nous allons traverser un champ de bataille, qui est couvert de morts ennemis, mais que cela ne doit pas nous émotionner. Plusieurs blessés sont encore étendus, mais nous ne devons leur montrer aucune haine, puisque ce ne sont que des combattants.
Nous partons donc par sections, nous approchons des allemands et nous n’avons plus qu’eux devant nous. Nous avons à peine marché que nous tombons en effet dans un véritable champ de carnage. Des sections entières ennemies ont été fauchées par notre artillerie. Heureusement que nous avons été prévenus car ce spectacle est vraiment horrible à voir. Des hommes étendus, dans une position différente pour chacun, la figure et les mains noircies par la poudre, couvrent le terrain. Il y en a qui ont encore le fusil à l’épaule, prêts à faire feu, des officiers tiennent leurs jumelles devant les yeux, c’est dans cette position qu’ils ont éprouvé la mort. Quelques blessés sont encore là, ceux qui ne peuvent marcher, il y en a qui sont sur un brancard, ils ont été abandonnés par les leurs, tellement notre attaque avait été soudaine. Nous ne nous arrêtons pas pour contempler nos victimes, notre temps est trop précieux. Nous gravissons rapidement un coteau, passant près de la ferme de Léomont[5], puis nous retombons sur une autre pente. Nous sommes arrêtés par l’artillerie ennemie et obligés de rester sur place. Nous creusons une légère tranchée pour nous garantir un peu des éclats d’obus, puis je suis envoyé en avant pour mieux découvrir ce qui se passe devant nous. C’est ainsi que j’ai vu arriver d’importants renforts allemands que j’ai signalé aussitôt à notre commandant et qui a fait tirer notre artillerie. Nous restons sur place jusqu’à la nuit, toujours sous les obus. Puis la pluie se met à tomber, il fait maintenant très noir et le combat cesse. Les cuisiniers nous font un potage, puis nous partons à Deuxville que les allemands ont dû évacuer dans la journée. Nous y arrivons vers 11 heures du soir. Les cantonnements sont très vite répartis, nous occupons seulement l’entrée du pays et il nous est interdit de nous déséquiper ainsi que de monter sur les greniers. Nous sommes en cantonnement d’alerte et le combat peut reprendre dans la nuit. Les habitants sont enfermés chez eux et sont très inquiets.
28 août 1914
Nous sommes réveillés avant le jour, il paraît que les allemands occupent l’autre extrémité du village. Il faut quitter immédiatement le pays, car tout à l’heure il sera peut-être trop tard.
Il était temps, car les dernières maisons sont à peine dépassées que nous recevons des coups de fusils. Nous retournons à l’arrière où nous étions hier soir avant de venir à Deuxville. Il fait jour à présent et de tous côtés on voit des soldats français et allemands tués dans les combats d’hier. Au coin du mur d’une ferme, ce sont des mitrailleurs du 69ème RI qui sont étendus, ils avaient tiré des milliers de cartouches, car les étuis sont là encore, qui gisent dans la boue nous nous arrêtons d’abord dans une houblonnière puis nous allons dans un petit boqueteau pour échapper à la vue de l’ennemi. Il pleut toute la journée, nous nous abritons tant bien que mal avec des branches. Puis nous creusons des tranchées profondes, toujours pour nous abriter des éclats, dans le cas où notre emplacement viendrait à être bombardé. La journée se passe assez tranquillement pour nous. Les obus arrivent de tous côtés, mais aucun n’atteint le bois.
Pendant 3 jours, nous demeurons à cet emplacement, les grosses marmites sont parfois tombées bien près de nous, il y a eu plusieurs tués et blessés à ma compagnie. Derrière nous, la ferme Léomont, qui est un superbe point d’observation pour nous, est complètement détruite par l’artillerie ennemie. Sans arrêt, pendant tout le temps que nous sommes là, les obus y arrivent par 4. A présent il ne reste plus que des pierres et des cendres.
Début septembre 1914
Cette nuit, j’étais parti avec plusieurs camarades à Anthelupt pour y chercher de l’eau pour notre consommation. En rentrant à la compagnie j’apprends que la division doit attaquer au jour. Il va donc falloir quitter ce petit bois, pourtant nous n’y étions pas trop mal. Les sacs sont montés, nous touchons un supplément de cartouches et une ration d’eau de vie.
Avant le jour nous nous portons en avant. Au même moment, d’autres régiments font comme nous, pour attaquer sur tout le front de notre division.
Nous arrivons à Deuxville que nous avions quitté il y a 3 jours. Ce pays est bientôt traversé et nous gravissons un coteau couvert de jardins et de vignes. Il fait jour maintenant et nous sommes aperçus, car nous recevons des coups de fusil. Nous sommes à 8 kilomètres de Lunéville. La 10 compagnie est devant nous et arrive sur la crête, mais tombe tout à coup sur un ennemi retranché qui les reçoit à bout portant. Nous arrivons juste à temps pour empêcher les nôtres de se replier, mais nous ne pouvons avancer plus loin. Notre attaque est ratée. Puis nous voici marmités copieusement et encore une fois nous avons recours à notre outil qui ne nous quitte pas pour faire une tranchée.
Il nous est difficile maintenant de reprendre notre attaque, nous sommes sur une pente dont la crête est occupée par l’ennemi.
Pendant 2 jours nous demeurons sur place, pendant la nuit, nous détachons des petits postes en avant et des patrouilles fouillent jusqu’à proximité des tranchées ennemies. Deuxville derrière nous dans la vallée reçoit, pendant ce temps, sa part de bombardement. C’est dans ce village que nous faisons notre cuisine.
8 Septembre 1914
On nous a annoncé notre relève pour cette nuit et c’est avec impatience que nous attendons les camarades qui doivent venir prendre notre place en première ligne. Nos sacs sont prêts. Il est près de minuit et personne n’arrive. Pourvu que la relève arrive ce soir, car nous n’en pouvons plus, depuis combien de temps n’avons-nous pas dormi une nuit tranquille, nous ne nous en souvenons plus.
Enfin on entend marcher, on prête l’oreille, on tâche de voir dans l’obscurité. Oui, ce sont des nôtres, ce doit être la relève. Nous chargeons notre sac et nous descendons la pente sans bruit pour ne pas attirer l’attention des allemands. Nous arrivons à Deuxville quand un contre ordre arrive, il nous faut remonter à notre position. La compagnie qui nous a remplacé doit aller autre part, et il nous faut attendre qu’une autre unité vienne prendre notre place. Nous remontons donc là haut, non sans râler, mais ceci n’améliore pas notre sort. Tout de même voici la troupe qui nous remplace et nous pouvons enfin prendre congé des 1ères lignes pour aller à l’arrière. Nous sommes conduits à Flainval où nous arrivons vers 3 heures du matin. Nous nous logeons comme nous pouvons dans des greniers et nous nous endormons vite.
……………
Le lendemain matin, en place du repos que nous attendions, il nous faut prendre des outils et partir construire des travaux de défense du côté d’Anthelupt. Nous travaillons jusqu’à midi. Dans les environs sont installés des batteries de 75 qui tirent par violentes rafales.
Nous rentrons à notre cantonnement où nous attend une bonne soupe. Les cuisiniers n’étant pas partis au travail comme nous, s’étaient chargés de nous préparer quelque chose de réconfortant.
L’après midi est employé au nettoyage du corps et du linge. Dans ce pays vient d’arriver une équipe de civils réquisitionnés pour enterrer les morts des derniers combats. Parfois, n’arrivant pas à creuser suffisamment de fosses, ils sont obligés de brûler les cadavres, car il y en a beaucoup et leur décomposition s’avance.
La soirée se passe donc pour nous assez tranquillement et je me serais couché de bonne heure si je n’avais pas été désigné pour aller chercher le ravitaillement en vivre pour la compagnie.
Les voitures arrivent enfin à 9 heures du soir et je pars à la distribution avec quelques camarades. La répartition commençait à peine quand tout à coup on entend venir vers le pays, un cavalier poussant son cheval à toute allure. Il est arrêté à l’entrée de Flainval par une sentinelle. Sans ralentir, le cavalier donne le mot d’ordre et demande le logement du Colonel. C’est un agent de liaison envoyé par le commandant du 2ème bataillon, celui qui nous a remplacé hier soir.
La distribution des vivres se faisait juste en face du logement du Colonel. Tout à coup nous le voyons apparaître, donner des ordres pour que la distribution n’ait pas lieu. Puis il fait venir le Commandant Salles, le nôtre. L’ennemi attaque en force sur le front du 2ème bataillon, il faut aller lui porter secours immédiatement.
Je rentre donc au cantonnement où l’alerte vient d’être donnée. Chacun s’apprête, s’équipe. Cinq minutes après tout le bataillon est rassemblé et nous partons dans la direction de l’attaque pour y porter secours. Nous avançons sans bruit, dans une obscurité profonde. De tout côté on aperçoit les lueurs vives de nos canons, crachant tout ce qu’ils peuvent pour enrayer l’attaque. Nous pénétrons dans des houblonnières où une batterie d’artillerie est masquée. Les artilleurs se hâtent d’enlever leur pièce, car l’ennemi gagne peu à peu du terrain. Sur la route de Lunéville à (un blanc), un projecteur automobile dirige ses rayons sur la zone de l’attaque. Par intervalle nous pouvons alors découvrir les sections d’infanterie qui se déplacent.
Deuxville est pris par l’ennemi, mais à quel prix. Il marchait à l’assaut des barricades installées dans les rues, marchant sur les cadavres sans se soucier du sort qui attendait celui qui s’approchait. Mais sous la masse, les nôtres durent abandonner le pays.
Nous nous arrêtons sur la crête dominant Deuxville. La fusillade se rapproche, les balles nous sifflent aux oreilles, nous creusons alors une petite tranchée, puis nous attendons les évènements. Enfin le combat se ralentit, le jour paraît, çà vaut mieux, car au moins nous verrons à qui nous avons à faire. Des petits postes sont placés en avant, à la lisière de petits boqueteaux, moi je suis envoyé pour me mettre entre eux en liaison.
Mais les allemands n’ont pas renoncé à leur attaque, car voici des détachements qui s’avancent sur nous et il en arrive de toutes parts. Nous envoyons quelques coups de fusils sur une patrouille. Les obus maintenant pleuvent dans notre direction. La position devient dangereuse pour nous. Mais un ordre arrive, il faut nous replier. Déjà des compagnies s’éloignent, nous faisons de même. Nous traversons Flainval, là un à coup se produit, car la tête de la colonne s’engage dans un sentier montant à la sortie du village. Nous sommes arrêtés dans le pays et nous en profitons pour prendre de l’eau. Mais tout à coup une détonation terrible, puis une deuxième, en l’air deux flocons d’une fumée noire se détachent, puis des camardes qui s’écroulent en hurlant. Deux obus fusants de gros calibres viennent d’éclater juste sur ma section. Il y a des tués et des blessés, Lutringer de Diarville est touché aux jambes. Un autre près de moi a la jambe brisée, on l’emporte sur des fusils. Et la colonne activant sa marche quitte rapidement le village. Arrivés sur une hauteur, nous sommes sans doute aperçus de nouveau car nous tombons encore sous un feu d’obus fusants, heureusement, ce sont des 77, il y a beaucoup de victimes. Nous ne faisons que traverser cette crête et nous tombons sur la route de Dombasle, là nous sommes un peu plus en sécurité. Nous passons la journée sous un petit bois et à la nuit, nous reprenons de l’avant et allons occuper la position que nous avions quittée dans la matinée. Nous allons d’abord dans des carrières, car nous sommes réserve du bataillon. Puis la compagnie va faire des travaux de défense un peu en avant. Je suis désigné dans la nuit pour aller garder les vivres du régiment que les voitures viennent de déposer au bord d’un chemin. Je pars avec un caporal, Bertrand, Chapelier et Paillot. Il y a là des gros quartiers de viande, du pain, sucre, boite de singe et plusieurs bonbonnes de gnôle. Chapelier prend la garde le premier, pendant que les autres, nous nous reposons dans une tranchée. Deux heures après, Chapelier me réveille, c’est mon tour de prendre la faction, mais je ne sais pas à quoi cela tient, je ne trouve pas mon camarade comme à l’habitude. Il a un manteau allemand sur les épaules. Puis il emplit son quart et me force à boire, c’est de la gnôle, lui en boit un autre quart à son tour.
Puis il m’emmène auprès des bonbonnes, emplit mon bidon et le sien. Mais mon camarade ne tient plus en équilibre, il était légèrement ivre. Tout ce ravitaillement risque fort d’être abandonné, je fais une bonne provision du plus nécessaire, pain et conserves, les copains en font autant.
Vers 5 Heures du matin au petit jour nous voyons passer successivement les compagnies du régiment, se dirigeant vers l’arrière. Cette fois encore nous battons en retraite. Et les vivres vont rester là, abandonnées à l’ennemi s’il arrive jusque là, ce qui paraît probable. En passant, quelques hommes sortent du rang pour prendre quelques provisions. Quand tout le régiment est passé, nous recevant l’ordre de rejoindre notre compagnie.
Avec mes camarades et le caporal, nous prenons la direction qu’a prise le 79ème RI. Nous traversons d’abord Anthelupt qui est presqu’entièrement démoli par les obus, quelques maisons achèvent de se consumer, il n’y reste plus d’habitant. Dans les environs, des compagnies du 69ème établissent des défenses (tranchées, abattis) ; Puis nous trouvons notre bataillon, derrière une crête, dans des taillis. Aussitôt nous creusons des tranchées pour nous mettre à l’abri de l’artillerie, nous travaillons ainsi jusqu’au milieu de l’après midi. Comme ravitaillement, nous touchons une boule de pain pour 10 et un peu de bouillon prélevé sur nos vivres de réserve. Heureusement que j’avais pris mes précautions et je partage avec les copains, les vivres que j’avais emportés ce matin. Un peu avant la nuit nous sommes remplacés et allons cantonner à St Nicolas de Port dans une abbaye ou couvent. Nous pouvons acheter quelques provisions et passons une bonne nuit quoi que nous couchions sur le plancher.
11 Septembre 1914
Nous quittons le village dans la matinée et allons occuper le bois où nous avons passé quelques heures hier avant l’attaque. Nous sommes à l’intérieur du bois, sous les arbres, personne du côté ennemi ne peut nous voir. Tout paraît tranquille, nous attendons les évènements, les uns dorment, d’autres écrivent quelques lettres, d’autres fument la pipe en blaguant. Quand tout à coup une marmite, quelque chose comme un 210 éclate à l’improviste tout auprès de nous, nous couvrant de terre, puis d’autres obus rappliquent à leur tour et nous voilà en plein sous un bombardement de gros calibre. Un bruit infernal, des arbres abattus, des morts et des blessés de tous côtés. Cela dure une demi-heure, mais qui semble pour nous ne jamais se terminer. La nuit venue, le bataillon encore une fois va coucher à Lenoncourt. Successivement les compagnies sortent du bois. Trois kilomètres environs nous séparent du pays. Aussitôt les premières sections sorties du bois, voici que le bombardement recommence, nous couvre et nous environne, allongeant comme nous avançons, comme si quelqu’un dans les environs réglait le tir ennemi. Impossible de sortir de dessous ce bombardement, c’est à croire qu’il y a par là quelque espion signalant notre présence, car dans l’obscurité, il est impossible que les allemands aient connu notre mouvement d’une autre façon.
Enfin après bien des péripéties, mais sans trop de mal pour ma compagnie, nous arrivons à Lenoncourt. Les voitures de ravitaillement sont là, nous touchons nos vivres et pendant une partie de la nuit, les cuisiniers font la croûte, pour ce soir et le lendemain matin.
12 Septembre 1914
Après une courte nuit, mais cependant bien employée à dormir nous nous éveillons par une matinée où le temps ne nous encourage pas à sortir dehors. La pluie tombe comme si l’on en avait bien besoin. Cependant il paraît que ce n’est pas une raison pour que nous demeurions à l’abri. On apprend que les allemands s’acharnent du côté du plateau d’Amance, il ne faudrait tout de même pas laisser envahir notre beau Nancy. C’est qu’ils n’en sont pas loin, les cochons !
Pour ne pas changer avec l’habitude d’obéir, nous quittons nos cantonnements, bien un peu de regret, car nous savons que là où nous allons, nous serons plutôt plus mal. Nous allons donc par des chemins boueux, trainant nos pauvres jambes qui n’en peuvent plus. Puis l’on nous fait rentrer sous bois où nous commençons à creuser des tranchées. De grosses gouttes glissent des feuilles à chaque fois que l’on remue une branche et bientôt nous sommes trempés comme si nous sortions d’un bain tout habillé. Pourtant on ne se plaint pas trop haut, on se contente de dire que la guerre est bien pénible par moment.
Sans doute que nous ne devenons plus utile dans ce bois, car après deux heures de travail, on nous en fait sortir et en suivant la lisière, échappant ainsi aux yeux de l’ennemi, nous marchons vers le Nord-est, du côté de Cercueil.
La pluie a enfin cessée, mais le vent est frais et nous grelottons sous nos frocs humides.
Il y a un petit arrêt et nous en profitons pour entamer une boite de conserve, car il faut manger si l’on veut avoir des jambes.
Nous arrivons à un chemin qui vient de Cercueil et traverse le bois. Il y a déjà quelques fractions d’autres régiments, puis d’autres arrivent. Après une courte délibération entre nos officiers. Le bataillon s’engage sous le bois, par section et en files indiennes, précédé de quelques mètres simplement par une patrouille. Ce bois devient si touffu que l’on ne voit pas devant soi, on n’entend rien que nos pas foulant les branches mortes.
Où allons-nous ainsi ? Sur quoi allons-nous tomber ? Nous autres ni pensons même pas, du moment que nous marchons ainsi c’est que nous devons être seul dans ce bois et qu’il n’y a rien à craindre. Au moment où nous allons traverser un chemin perpendiculaire à notre marche, voilà tout à coup un feu de salve qui part de quelques mètres de devant nous et couche par terre plusieurs d’entre nous. Un instant nous demeurons sans savoir ce que nous devons faire, tellement la surprise a été soudaine, mais bientôt nous nous ressaisissons et nous nous lançons dans le fossé bordant le chemin sans nous soucier qu’il est transformé en ruisseau depuis la pluie du matin.
Alors nous commençons à tirer dans la direction de nos assaillants qui demeurent toujours invisibles à nos yeux. À quelques pas devant nous on peut distinguer des branches entrelacées, des fils de fer pour arrêter notre marche si nous voulions nous lancer en avant. Mais avant tout, il faudrait savoir à qui nous avons à faire, l’ennemi doit être retranché par derrière les arbres et se défie de nous. Notre feu a calmé un peu celui des allemands puis on entend partir des clameurs devant nous. « Ne tirez pas, ne tirez pas, il y a des Français ici ». Chacun s’empresse d’obéir, en pensant que l’on a fait erreur et que l’on a tiré sur des camarades. Mais à quelques mètres, le capitaine Lacapelle, qui est resté debout au milieu des balles, s’aperçoit de la supercherie des allemands et ordonne de continuer le feu. Une fois de plus, notre adversaire, se servant de notre langue nous trompait et allait profiter de notre confusion pour nous tomber dessus. Alors la fusillade reprend de plus belle, décidément on n’est plus en sécurité, les balles hachent les branches, passent si bas qu’elles ricochent sur le chemin. C’est là que le sergent major Moquerau[6], Etienne[7], Richard[8] sont blessés, Crapet tué.
Nous appuyons un peu plus à droite pour porter nos feux de flanc, c’est peut-être ce qui nous sauva tous. Mais dans notre précipitation nous avons oublié Richard, un type qui en avait dans le ventre. Le malheureux a la cuisse broyée par une balle et ne peut plus bouger, on ne peut le laisser car il va tomber aux mains de l’ennemi. Quatre camarades de l’escouade se risquent auprès de lui et le ramènent dans une couverture. On lui fait un pansement et comme on ne peut l’emporter en ce moment, on l’étend auprès de nous. Pendant que la fusillade continue, le pauvre Richard perd la tête et se roule dans le fossé rempli d’eau boueuse, sans se douter qu’il envenime sa blessure déjà énorme. Enfin au moment d’une accalmie on l’emporte à l’abri d’un gros arbre, où il reste jusqu’au lendemain matin, presque sans connaissance.
Jusqu’à la nuit, nous restons sur cette position défendant l’accès des routes aux allemands. Quand l’obscurité fut complète, nous nous reportâmes un peu à l’arrière du chemin et nous creusâmes une tranchée. J’ai l’occasion de voir Emile Humbert[9] conduisant une mitrailleuse, je ne l’avais pas vu depuis le début de la campagne.
Nous employons toute notre énergie pour creuser et surtout veiller, il fait une nuit noire, on ne distingue pas à un mètre devant soi. Autour de nous on entend que les cris des blessés et le râle des mourants. Comme c’est triste. Avec cela le brouillard est devenu très épais, il fait froid. La nuit s’est passée sans trop d’incidents. Quelques coups de fusil, les cris des sentinelles qui arrêtent. Et le matin nous trouve où nous étions installés la veille, toujours un peu plus fatigués, voilà tout ! Nous recevons un léger casse-croûte que les cuisiniers sont allés préparer pendant la nuit (un quart de café froid, un morceau de pain et de viande froide). Dès le lever du jour des patrouilles ont été lancées en avant, fouillant la forêt, l’ennemi s’est un peu retiré. Quelques coups de fusil puis le canon à son tour déchire l’air de son bruit infernal. Une batterie vient d’être abandonnée et l’infanterie allemande qui devait la protéger a dû se retirer en vitesse, aussi profitant de l’occasion, les conducteur d’une batterie du 8ème RAC s’empressent de ramener ces canons dans nos lignes, juste au moment où les casques à boules venaient, mais trop tard, pour les retirer.
Pendant ce temps, le capitaine Lacapelle, de la 10ème compagnie est allé avec une patrouille reconnaître la forêt en avant de nous. Nous autres faisons un rapide nettoyage de nos armes, c’est qu’il faut en ce moment plus que jamais que nos fusils soient en bon état. Mais voilà qu’en passant la baguette dans le canon de mon flingot, le chiffon se trouve coincé et plus moyen de l’en ressortir, quel sale tour, aussi je ne suis pas bien rassuré. Je ne vois plus que le moyen d’en chercher un, abandonné la veille par des blessés, mais je ne vois que des fusils presque inutilisables. Heureusement que pendant ce temps, Chapelier et Bertrand se sont acharnés pour me remettre le mien en état, ils y arrivent après bien des efforts.
Le capitaine rentre avec sa patrouille, d’après ses renseignements nous repartons en avant. L’ennemi n’est pas très loin car la fusillade se fait bientôt entendre et déjà nous rencontrons des blessés. Dan quelle direction marchons nous, je ne le sais au juste, probablement vers le Nord-est, sous cette énorme broussaille c’est difficile de s’y reconnaître. Nous n’avançons que lentement, arrêtés par des ronces et les épines et surtout prudemment. Bientôt nous nous installons sur place, faisant de légères tranchées tantôt face à une direction, tantôt face à l’autre. Pas bien loin de nous, d’autres régiments sont aux prises avec l’ennemi, nous sommes là probablement en cas de repli des nôtres.
La nuit nous trouve dans cette position d’attente, ce qui amène un semblant d’accalmie et nous n’en sommes pas fâchés, car on redoute toujours des instants critiques. Mais avec la nuit, la pluie est venue légèrement d’abord, mais prenant rapidement de grandes proportions. Et nous sommes là, sans abri, pataugeant dans le fond de notre tranchée. Nous avions bien installé quelques branches pour nous préserver de cette intempérie mais ceci était bientôt devenu inutile et même nous gênait plutôt. Le froid nous glaça bientôt sous nos capotes trempées, aussi la nuit nous sembla-t-elle longue, avec cela l’obscurité était complète. Heureusement que l’ennemi nous laissa tranquille. Il n’en fut pas de même avec les unités avoisinantes qui furent alertées plusieurs fois dans la nuit.
Enfin le jour vient insensiblement, personne n’a fermé l’œil de la nuit, la pluie tombe plus fine. Nous enlevons, avec nos couteaux, la plus grande partie de la boue qui se colle à nos effets et pour nous réchauffer nous avons d’autres ressources que celle de « battre la semelle », il ne faut pas songer à changer de linge, celui qui est dans notre sac est complètement mouillé.
Allons-nous rester dans cette situation, tombant de fatigue et le ventre bien creux, chacun se pose la question,
Mais dans la matinée, les cuisiniers qui étaient partis nous chercher des vivres, s’en reviennent nous annonçant que nous allions être remplacés par d’autres troupes. La nouvelle se confirme bientôt et nous ne tardons pas à voir arriver un régiment d’infanterie coloniale venant prendre nos positions. Inutile de dire si nous sommes heureux de laisser la place aux nouveaux venus en leur souhaitant bonne chance. Bien vite et sans être inquiétés nous partons pour l’arrière et regagnons Lenoncourt, nous y mangeons un peu et, dans la soirée, nous allons à Varangéville, où nous logeons dans une salle de bal.
13 Septembre 1914
Nous restons deux jours à Varangéville, que nous employons à nous nettoyer sérieusement. Depuis le début de la guerre nous ne nous étions pas encore trouvés à l’arrière, aussi c’est bien notre tour. Va-t-on nous laisser longtemps en repos, nous nous le demandons bien. Mais voilà que l’on parle de faire embarquer le 20ème Corps et l’emmener sur une autre partie du front.
Le 69ème RI passe devant notre cantonnement allant pour s’embarquer, j’ai l’occasion de voir Émile Humbert. Puis vient le 156ème RI, je le regarde passer machinalement et tout à coup, oh ! Quelle joie, j’aperçois Marc[10] qui fait partie de ce régiment, j’ignorais où il était depuis la mobilisation. Comme nous sommes heureux de nous revoir sain et sauf et de nous embrasser. Je fais un court chemin avec lui mais nous sommes obligés de nous séparer (et quand nous reverrons-nous) et je rejoins mon cantonnement.
A la nuit, l’ordre est donné de nous tenir prêt à partir d’un instant à l’autre, ce qui ne nous empêche pas de nous coucher comme la veille et de nous retrouver à la même place, heureusement, le lendemain matin.
14 Septembre 1914
Dès le matin, nous recevons l’ordre de nous préparer à partir. Le temps de faire un quart de jus et le sac au dos nous partons. Nous passons à St Nicolas puis prenons la direction de Nancy. Je ne crois pas que nous embarquions maintenant, il ne doit pas y avoir de train de prêt, les régiments 69ème RI et 156ème RI que nous avions vus hier ne l’on pas fait. Sans plus nous préoccuper de ce que nous allons devenir, nous suivons le mouvement, nous sommes habitués à cela.
Voilà Nancy que nous n’avons pas revu depuis le 30 juillet, nous sommes heureux d’entendre résonner ses pavés. Nous faisons un court arrêt devant l’église de Bonsecours, pendant lequel beaucoup de nancéens accourent pour nous voir. Plusieurs d’entre eux font de petits cadeaux aux soldats qui se trouvent là (chocolat, sandwiches). Puis le régiment se remet en marche, entouré par une foule toujours grossissante. Il y en a qui voit leur famille et c’est avec beaucoup de peine, on le comprend, qu’ils se séparent. Nous prenons la rue du Montet, allons-nous rejoindre notre caserne pour quelques jours, nous serions content de la revoir, tant pis si autrefois on s’ennuyait. Mais non, car nous tournons rue Jeanne d’Arc. Cette fois la foule est si nombreuse que c’est à peine si nous pouvons avancer, puis nous ne nous pressons guère non plus, à droite et à gauche on veut nous retenir, nous donner quelques friandises (cigares, cigarettes, chocolat, bonbons, voire quelques vieilles bouteilles), nous nous laissons faire comme de grands enfants, ne remerciant même pas toujours ces généreuses personnes car nous sommes déjà entraînés par d’autres. Je vois successivement Mr Granjean qui m’offre de l’argent, mais je n’en ai pas besoin, puis Léontine Munier qui me glisse la pièce à toute force, puis je rejoins vite ma place car le capitaine nous observe que nous marchons en désordre. Nous sortons de Nancy par la route de Toul et peu à peu tout rentre dans le calme, plusieurs soldats avancent le cœur gros, car une fois de plus ils viennent de quitter leur famille. Et nous voilà arpentant la route et tirant sur la bretelle du sac qui se fait sentir.
La pluie se met à tomber, nous arrivons aux baraquements dits « cinq tranchées », nous nous y abritons le temps de faire la croûte de midi. Puis nous allons cantonner dans un village voisin de Fontenoy, probablement Aingerey. J’achète un lapin que nous mangeons entre plusieurs camarades. Nous ne sommes pas très bien couchés, n’ayant pas beaucoup de paille, puis nous sommes encore mouillés de la pluie de la journée.
15 Septembre 1914
De bon matin, nous quittons le pays, traversons Fontenoy[11], passons près de Toul, Ménil-la-Tour et après une étape bien pénible nous arrivons à Royaumeix (310 habitants). Nous sommes heureux de trouver un bon cantonnement, nous avons de la paille à volonté. Près de Ménil-la-Tour je vois Félicien Dupré, qui est au 42ème Territorial, il fait des tranchées dans les environs.
16, 17, 18, et 19 septembre 1914
Ce petit séjour à Royaumeix nous a certainement fait du bien, pouvoir dormir toute une nuit dans la paille, sans le souci d’être alertés, c’est seulement aujourd’hui que nous en connaissons l’importance, aussi nous en profitons.
Le 16, j’ai la joie de me voir coudre sur les manches les galons de 1ère classe, avec Calbrix, Ducange et Durand[12]. Ce même jour nous recevons un renfort important en hommes et gradés, c’est la deuxième fois que le régiment est reformé. Nous n’avions plus de chef de section, c’est l’adjudant Mouille, un nouvel arrivé, qui le remplace. C’est un méridional, ancien sous-officier de carrière et qui avait déjà eu sa retraite, il a été nommé adjudant depuis sa mobilisation. Il parle beaucoup et veut démolir beaucoup d’allemands, mais il n’a pas encore vu le feu, aussi on le laisse dire et on sourit, nous verrons plus tard ce qu’il sait faire. Pendant les jours suivants, nous allons faire quelques heures d’exercice aux environs.
Le 19 nous quittons Royaumeix et l’on parle de nouveau d’embarquer pour une direction encore inconnue pour nous. Nous repassons à Ménil-la-Tour et je rencontre à nouveau Félicien Dupré, passons près des fortifications de Toul et marchons jusqu’à Bulligny. Mais nous n’y passerons pas la nuit, néanmoins nous sommes cantonnés et pouvons nous reposer quelques heures.
20 septembre 1914
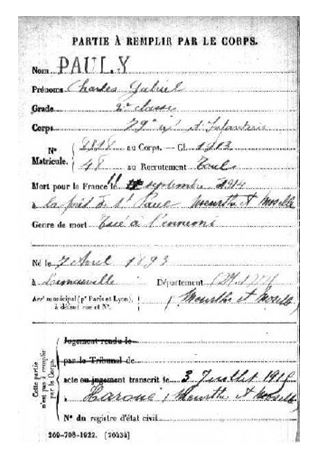
Nous attendons sur le bord de la route que notre train soit formé, nous recevons aussi des vivres pour le parcourt et une petite couverture et au petit jour nous prenons place dans nos wagons, des wagons de marchandises, aménagés pour les circonstances. Nous nous casons tant bien que mal, 32 par voiture.
À 5 heures et demie tout est terminé, le coup de clairon annonçant le départ et nous roulons, où, on se le demande, mais sûrement nous rejoindrons l’ennemi quelque part.
Nous passons à Neufchâteau puis reprenons la ligne de Paris. Alors nous roulons d’une bonne allure, traversant des pays jusqu’alors inconnus, pour moi ainsi que beaucoup d’autres et que nous avons le temps d’admirer par la porte grande ouverte de notre wagon.
Puis voici Paris que l’on aperçoit dans le brouillard, nous suivons la ligne de ceinture et à présent plus rien, c’est la nuit et nous filons toujours, nous essayons de nous installer pour dormir un peu, mais nous n’y parvenons guère étant trop serrés, nos membres s’engourdissent sur ces banquettes trop dures pour un long voyage, puis le vent qui passent au travers des planches nous glace. Que la nuit nous paraît longue dans de telles conditions.
21 septembre 1914
C’est avec un certain soulagement que nous voyons le jour, notre wagon nous faisait l’effet d’une prison durant la nuit, l’obscurité, le froid à présent nous voyons au moins, nous mangeons quelques conserves ce qui achève de nous remettre un peu mieux d’aplomb. De chaque côté de la ligne de jolies petites maisons en briques rouges et des pommiers, des pommiers partout, nous arrivons en Normandie. Nous passons près de Rouen, nous apercevons ses clochers pointus et des ponts sur la Seine. Nous laissons la ville à notre gauche et voyageons vers le Nord.
Vers midi nous arrivons dans la Somme. Là nous ne pouvons plus aller plus loin, un viaduc où passait notre ligne a été coupé récemment pendant la retraite et notre train est obligé de s’arrêter. Après un voyage de 30 heures nous débarquons en pleine campagne. Nous sommes obligés de nous procurer des planches pour décharger les voitures et faire descendre les chevaux. Tout le monde est à terre à présent et nous nous rendons à un pays qui se trouve tout près. C’est Poix, nous y faisons une halte repas. Il fait froid, aussi je suis bien aise de pouvoir m’acheter un tricot.
Après une heure d’arrêt nous nous remettons en route vers le front. Pendant trois jours nous allons ainsi en marche forcée. Afin de diminuer un peu la fatigue, des voitures ont été réquisitionnées chez les paysans et une partie de nos sacs, à raison de un sur deux y sont chargés, ce qui fait que nous nous relayons par moitié pour porter l’as de carreau[13].
Le 23, nous passons la nuit à Villers-le-Bretonneux. Le 24 au soir, nous arrivons à proximité de l’ennemi. Au lieu d’avoir toute la nuit pour nous reposer comme aux étapes précédentes, nous quittons le cantonnement vers 11 heures-minuit et nous marchons tout le restant de la nuit. Cette fois encore, des voitures nous suivent et portent une partie des sacs.
25 septembre 1914
Bataille de Capy
Un peu avant la levée du jour, nous reprenons tous nos sacs et renvoyons les voitures de réquisition. Nous ne sommes plus très loin de la ligne de feu. Nous quittons la route et bientôt nous pénétrons en sous bois où l’on nous arrête un instant. Nous en profitons pour manger un peu, j’ai du café dans mon bidon, j’en fais chauffer un quart à l’aide d’une bougie. Puis le jour s’achève lentement, les ordres sont donnés, nous sortons du bois et par section nous avançons en profitant des couverts. L’ennemi n’est plus loin, nous dit-on. Alors après avoir passé une douzaine de jours l’esprit tranquille, nous voici encore une nouvelle fois lancé dans la bataille. Le soleil maintenant éclaire la campagne, la journée s’annonce belle. On perçoit quelques coups de fusil, puis le canon fait entendre sa voix de plus en plus au fur et à mesure que nous approchons. Voici Braye, puis la Somme, la rivière que nous traversons. Un peu plus loin, un village sur lequel tombe des obus, nous n’avons que le temps de nous lancer derrière le mur d’une cour de ferme, les éclats volent alors de tous côtés. À la section personne de touché, tant mieux. Un habitant nous apprend que les prussiens ont été chassés dès le matin du pays par les chasseurs à pieds. Ils sont maintenant au dessus de la côte. Nous quittons bientôt le village et par un chemin de terre longeant un bois, nous gagnons le plateau. Les obus de gros calibres nous arrivent plus nombreux. L’adjudant Mouillen qui faisait le vaillant à Royaumeix voit cela d’un air mal assuré. Enfin, peu à peu nous gravissons la crête pour voir la grande plaine. Sur le plateau, la fusillade fait rage, il s’agit de prendre place sur la ligne de bataille où déjà d’autres compagnies sont engagées. Mais devant nous, le chemin que nous avons à traverser est balayé par les balles. Il s’agit d’abord de gagner un petit repli de terrain, des anciennes fondations d’une maison détruite (briqueterie) alors par groupe de cinq successivement, nous gagnons rapidement cet emplacement. Déjà de nombreux blessés y sont réfugiés, un peu plus loin des chevaux et des mulets des mitrailleurs s’échappent effrayés, leurs conducteurs ayant été fauchés par une mitrailleuse ennemie. Ma compagnie est alors toute rassemblée. Par section et par bonds rapides, nous nous lançons en avant sous une vive fusillade complétée par le feu des canons allemands. Nous voici en plein dans la bataille, tantôt nous avançons en courant, tantôt en rampant. À chaque arrêt, nous creusons un peu dans la terre avec notre outil portatif afin de nous préserver autant que cela est possible, des balles qui nous arrivent de face et de droite.
L’ennemi dissimulé dans des champs de betteraves, recule peu à peu. Bientôt nous constatons l’effet de notre tir par les morts qui restent sur le terrain.
Mais voici la nuit et peu à peu l’attaque se ralentit, des deux côtés on garde à peu près les mêmes positions que l’on se contente d’améliorer un peu. En effet, sitôt l’obscurité, des éléments de tranchées se formaient rapidement. Le ravitaillement ne nous arrivant pas ce soir, nous nous contentons des vivres de réserve. Étant en première ligne, nous devons demeurer constamment éveillés, d’ailleurs personne ne songe à dormir sachant que notre sécurité n’est pas complète.
Cependant pour notre compte, la nuit se passe sans que nous soyons trop inquiétés.
26 septembre 1914
Au matin nous touchons un quart de jus prélevé sur notre réserve. La journée s’annonce aussi belle que la veille. Ne recevant pas d’ordre de mouvement, nous améliorons notre tranchée, puis faisons un petit nettoyage au fusil.
Autour de nous, il n’y pas grand mouvement, mais l’artillerie se met peu à peu en action de part et d’autre. Puis le bruit court que nous allons bientôt nous porter en avant. À notre gauche, une vive fusillade se fait entendre, c’est le village de Dompière qui est attaqué par un bataillon du 79ème et un du 26ème R.I. Alors à notre tour, nous avançons prudemment, mais sans mal, l’ennemi semble avoir abandonné une partie du terrain devant nous. Nous allons ainsi jusqu’à un petit bois qui est libre, mais où l’on peut reconnaître les emplacements abandonnés par l’ennemi par les quelques morts qui y restent et des effets et équipements de blessés. Puis voici un groupe de prisonniers conduits au poste du Colonel. À droite c’est un détachement de cavaliers (5ème Hussards) déployé en fourrageurs partant en reconnaissance. Puis voici la 4ème section de ma compagnie, sous le commandement du Lieutenant Piot, qui part aussi dans Dompierre pour se mettre en liaison avec nos troupes chargées de prendre le village. Pendant ce temps, nous demeurons sous le bois, prêts à agir d’un côté ou de l’autre, selon les circonstances.
À la tombée de la nuit, la fusillade cesse ; notre 4ème section réapparait, Dompierre est à nous. Un groupe de 75 passe à ce moment près de nous et va se mettre en batterie un peu plus loin, bientôt il dirige ses feux de l’autre côté de Dompierre puis tout rentre peu à peu dans le calme. Des petits postes sont alors formés pendant que les autres troupes procèdent à quelques travaux de défense, car il faut toujours s’assurer pour garder le terrain conquis.
Vers 10 ou 11 heures, je suis envoyé avec d’autres camarades, pour toucher des vivres à Capy, les voitures de ravitaillement devant y arriver dans la nuit. Nous avons beaucoup de peine à nous diriger dans l’obscurité pour retrouver le pays que nous avons traversé la veille et ce n’est qu’après bien des tâtonnements et une marche de plusieurs heures que nous tombons sur le village masqué derrière un bois, sans cela nous aurions aperçu plus tôt les lueurs de plusieurs maisons incendiées par les obus et achevant à présent de se consumer. Le centre du pays ressemble à un véritable brasier. Nous nous dirigeons vers quelques hommes du 26ème RI, en train de faire chauffer un bouillon sur quelques charbons retirés des décombres. Nous nous chauffons un instant pendant qu’un des soldats du 26ème nous fait un récit de la prise de Dompière où il s’est battu dans la journée. Puis tombant de fatigue, voyant que les voitures n’arrivent pas, nous nous couchons dans les décombres d’une ferme pendant qu’un de nous veille, mais le froid nous tient éveillé malgré nous. À 4 heures du matin, rien n’étant arrivé, nous nous décidons à rejoindre la compagnie, naturellement les mains vides à la grande déception de tous. Nous arrivons juste au moment où elle quitte ses emplacements et nous reprenons notre place dans le rang.
Nous allons occuper un château-ferme à Fontaine-les-Capy où d’autres compagnies viennent nous rejoindre.
La 9ème compagnie va occuper un bois en avant, les trois autres compagnies du bataillon restent dans les dépendances de la ferme. Il n’y a pas longtemps que l’ennemi en est parti, on voit encore dans un coin des outils et des brancards qu’il a abandonnés. Quelques temps après notre entrée dans la ferme, nous voyons enfin arriver les voitures de ravitaillement, à la grande satisfaction de tout le monde. La distribution est vite faite et l’on s’arrange bientôt pour préparer à manger. Nous remarquons en même temps qu’il n’y a plus d’autres habitants que nous ici, les propriétaires se sont enfuis à l’approche de la bataille, nous avons entrée libre partout, toutes les portes étant ouvertes. La cuisine et ses ustensiles nous servent pour faire notre soupe. Je retire un panier de dessous un lit et y trouve 6 œufs qui sont bientôt changés en une belle omelette que je mange avec Bertrand et Chapelier, comme tout vient à point au même moment, le conducteur de la voiture à vivre m’avait justement donné de la graisse et du pain en plus de ma ration réglementaire.
D’autres soldats ont visité la cave, mais n’y ont rien trouvé que des bouteilles vides semées pêle-mêle, les prussiens avaient fouillé avant. Nous avons appris le lendemain qu’on avait vu des allemands, roulant une pièce de vin sortie de cette cave et l’emmenant aves eux pendant leur retraite.
Nous devons nous montrer dehors le moins possible, par crainte des avions qui ne manqueraient pas de faire bombarder le château et ses dépendances s’ils les savaient occupés. Heureusement pour nous, nous ne sommes pas inquiétés, pourtant nous nous attendions à chaque instant à être alertés, la fusillade ne diminuant pas autour. Dans l’après-midi, la soupe est mangée. Sur le soir, nous quittons ces demeures, et à travers des jardins et des vergers, de façon à marcher sous des couverts, nous gagnons Chuignes, petit village tout proche. Nous sommes probablement en réserve à présent car nous sommes cantonnés, nous pouvons dormir dans la paille pendant toute la nuit. Nous restons à Chignes également la journée du lendemain.
Nous allons voir le travail qu’a fait notre artillerie pendant les jours précédents. À deux cents mètres de notre cantonnement, une batterie de 77 ennemie a été à peu près complètement démolie, deux canons et deux caissons sont restés là, broyés, éventrés, et autour des pièces gisent une dizaine de cadavres des artilleurs, les uns décapités, d’autres le ventre ouvert et les membres enlevés, quoi que ce soient des ennemis que nous ayons sous les yeux, ce spectacle est vraiment touchant et plein d’horreur. À 10 heures du soir, nous quittons Chuignes et marchons pendant plusieurs heures. Nous repassons à Brayes-sous-Somme et nous arrêtons à Baneulille devant Brayes pour y passer le restant de la nuit qui est déjà bien avancée. Nous sommes logés dans un grenier au dessus de la Mairie. Ma section doit fournir la garde de police. Peu après que je m’étais couché, on vient me chercher pour être planton au poste. Il faut alors que je reconnaisse au milieu de la nuit le logement des officiers et des autres sections de la compagnie, si bien qu’au lieu de me reposer comme j’en aurais besoin, je suis obligé de courir de tous côtés.
Aussi c’est avec un certain soulagement que je vois arriver le jour.
29 septembre 1914
Prise de Maricourt.
Dès le matin tout le monde est debout, les officiers reçoivent des ordres détaillés pour les opérations de la journée, pendant que les cuisiniers nous préparent un jus à la hâte. Déjà le bataillon est rassemblé sur deux rangs. Dans la rue principale du village, puis comme nous ne partons pas encore, on donne l’ordre de faire cuire la viande pour la journée. Les feux sont encore allumés depuis que l’on a pris le café, les portions sont jetées dans un plat avec un peu de graisse, mais à peine sont-elles sur le feu que l’on crie « sac au dos » et en route, forcé d’emporter sa viande toute saignante dans sa musette. Nous avançons d’abord dans la campagne au travers d’un épais brouillard. Puis suivant un chemin bordé d’étangs, nous ne tardons pas à arriver à Suzanne, et de là nous allons nous loger dans un petit bois. Nous n’y restons pas longtemps, bientôt, par compagnie, nous partons et suivons une vallée, profitant des talus et marchant en file, nous arrivons à un chemin de terre qui conduit de Suzanne à Maricourt. Devant nous la fusillade commence à se faire entendre. Nous arrivons à une carrière où déjà est installé le Commandant Pétin[14], commandant le régiment. De là jusqu’à Maricourt qui est encore éloignée de 1 à 2 kilomètres, le chemin est en plein découvert, constamment balayé par les balles et les obus. Cependant il nous faut gagner l’entrée du pays déjà occupé en partie par nos troupes. Par petits groupes de 6 à 8 hommes nous allons nous lancer dans cette plaine, sous cette grêle meurtrière. Je reçois le commandement d’un groupe et à mon tour je m’élance, suivi de mes camarades, quand les balles sifflent de trop près ou que nous entendons arriver l’obus, nous nous aplatissons pour repartir encore plus vite aussitôt que la rafale est passée. Nous arrivons enfin, tous essoufflés, aux premières maisons, nous nous jetons dans un fossé où nous reprenons haleine pendant quelques minutes. Une partie de la compagnie est déjà là, puis d’autres groupes arrivent encore. Notre section se trouve alors au complet, nous pénétrons dans le village sur lequel commence à pleuvoir les obus, nous pénétrons dans la cour d’une ferme, pour dégager la rue en même temps que pour nous abriter des balles, en attendant que l’on ait besoin de nous. On se bat tout près de nous avec acharnement, l’ennemi vient de quitter le village, mais est solidement retranché dans un bois touchant aux habitations. Puis nous avançons à notre tour, presque jusqu’à la sortie du pays, nous sommes reçus par un feu nourri prenant la rue en enfilade, nous avons juste le temps de nous lancer derrière un mur où nous pouvons nous abriter. À ce moment la fusillade fait rage, les balles arrivent de toutes parts, brisant avec un bruit sec les tuiles qu’elles rencontrent, traversant la plupart des murs des maison qui sont bâties en torchis. Au bout de la rue, une compagnie est déployée dans le fossé du chemin, face au bois, une autre dans une position à peu près semblable occupe des jardins et tire sur les allemands massés dans le bois, mais ceux-ci semblent vouloir garder cette position car ils ne cèdent pas. D’ailleurs, ils ont sur nous certains avantages, abrités derrière les arbres, ils disparaissent à nos yeux tandis que nous, en plein découvert, nous sommes de jolies cibles mobiles pour les fusils. Il en est parmi eux, et les meilleurs tireurs sûrement qui perchés dans les branches tirent sur nous tout à l’aise tandis qu’ils ne craignent rien de nos balles qui passent au dessous d’eux. Mais nous nous apercevons de cette ruse. Voici que l’on vient chercher les meilleurs tireurs parmi nous, pour faire face à ceux perchés dans les arbres, les nôtres montent sur les toits et s’installent derrière les cheminées. Cette position très périlleuse à pareil moment coûte la vie à plusieurs d’entre nous. Le Capitaine Lacapelle reçoit une balle mortelle en plein front, près de lui le Commandant Salle est blessé, le sergent Bresson, mon ancien caporal est tué et combien d’autres malheureusement ont le même sort. Pendant ce temps ma section reste aplatie derrière son coin de mur, nous baissons la tête ou ramenons le sac par-dessus, chaque fois qu’un obus vient s’écraser près de nous, réduisant les maisons en poussières ou allumant un incendie quand il éclate dans un grenier. Voici une équipe d’hommes apportant des musettes pleines de cartouches aux compagnies qui sont engagées, les munitions distribuées, elle s’en retourne en chercher d’autres.
Peu à peu enfin, l’ennemi cède un peu de terrain, des zouaves et des marsouins aidant de leur côté, à la nuit, Maricourt est déjà un peu dégagée, les rues moins menacées, la fusillade ralentit et finalement se tait. On n’entend plus que les cris des blessés que les brancardiers évacuent et le râle des mourants, de temps à autres un obus passe très bas pour aller tomber quelques centaines de mètres plus loin. Nous avons eu notre part d’émotion, quoi que n’ayant pas encore été les plus malmenés, nous avons la fièvre, cette odeur de poudre et de sang qui nous entoure, nous avons soif, un camarade va chercher de l’eau à une pompe voisine, puis je retire de ma musette le morceau de viande crue touché ce matin et je le mange avec un oignon, ce n’est pas mauvais.
Quand les avant-postes sont installés on nous ramène un peu en arrière pour passer le reste de la nuit. Nous dépassons le corps du Capitaine Lacapelle, porté sur une échelle en guise de civière par ses agents de liaison, un mouchoir recouvre la figure du Capitaine, la balle meurtrière lui a fait voler le crâne en morceau, la cervelle en est sortie. C’est un bien triste cortège, dans ces rues de Maricourt, à plusieurs coins du pays brûlent des maisons, se communiquant librement le feu les unes aux autres. Nous sortons de ce lieu sinistre et reprenons le chemin que nous avions parcouru sous les balles pendant la journée. On nous arrête le long du talus, près du chemin, où nous ne tardons pas à nous endormir, les nerfs et l’esprit brisés. Durant toute la nuit, çà n’a été qu’un défilé de voitures réquisitionnées, charriant des blessés. Pour mon compte je l’ai échappé belle, étant couché près du chemin, la tête sur mon sac, la roue d’une voiture est venue broyer ma gamelle, effleurant ma tête de quelques centimètres pendant que je sommeillais.
30 septembre 1914
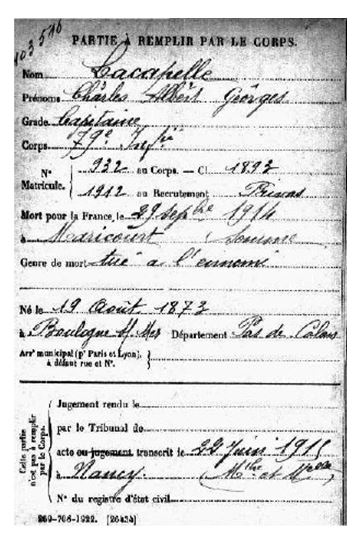
Nous cassons la croûte que des camarades sont allés préparer à Suzanne et aussitôt nous repartons par section vers Maricourt. Déjà l’ennemi a vu notre mouvement et nous accompagne de ses obus.
Nous arrivons au village par où nous étions entrés la veille, nous revoyons ses rues encore plus démantelées qu’hier, des barricades avaient été dressées, de tous côtés des trous d’obus, des morts étendus le long des maisons effondrées. Un officier nous indique notre direction, voici le mur au pied duquel nous nous sommes aplatis tout l’après midi d’hier, puis l’endroit où le Capitaine Lacapelle et beaucoup de camardes ont trouvé la mort. Nous sortons du pays et tout de suite à droite c’est le bois dans lequel, nous pénétrons par une vaste allée. Dans ce coin qui autrefois devait être souriant, la mort à fait des ravages terribles, amis cette fois, ce sont des allemands que nous foulons du pied, les uns déchiquetés, les membres enlevés, au milieu d’un tas de branchage abattu par nos obus, certains aussi ont encore le fusil en main, des centaines de cartouches tirées sont projetées autour de ces cadavres. Les survivants se sont retirés, peut-être même ont-ils abandonné tout ce bois, mais nous n’avançons qu’avec précaution et aussi difficilement parmi les broussailles et les épines.
Arrivés à un carrefour, une reconnaissance est envoyée en avant pendant que nous nous arrêtons et creusons une tranchée. À ce moment la canonnade devient terrible et c’est sous ce vacarme infernal, multiplié encore par l’écho de la forêt, que nous creusons notre tranchée jusqu’à la nuit, c’est la même violence d’artillerie, aussi nous en avons les oreilles fatiguées. Peu à peu, le bombardement cesse enfin et l’on n’entend plus que quelques coups de fusils échangés entre patrouilles et avant-postes.
L’ennemi a tout à fait quitté ce bois, et la lisière est occupée par une compagnie du bataillon. Nous autres nous restons à nos emplacements mais dans la nuit ma section appuie un peu sur la gauche, en bordure s’un pré. Il fait une nuit noire, nous ne voyons pas à un pouce devant nous, aussi nous observons plus avec nos oreilles qu’avec nos yeux.
1er octobre 1914
Ce jour arrive sans qu’aucun incident se soit passé, un brouillard épais et froid nous environne, nous reconnaissons alors notre position, à deux pas de l’endroit où j’ai passé la nuit, un jeune tirailleur indigène est étendu. Il a pris une balle en pleine tête, le pauvre soldat, tué pendant l’attaque d’hier, avait tiré presque toutes ses cartouches car une centaine de douilles sont semées autour de lui. Derrière nous, dans un vaste verger, servant en même temps de pâturage, un spectacle peu ordinaire s’offre à nos yeux, une vingtaine de vaches, qui avaient dû être chassées là par le propriétaire sans doute au moment de l’approche de la bataille, ont été fauchées par la mitraille, seul un jeune veau de quelques mois a réchappé à cette tuerie et se promène. Toute la journée, nous en profitons pour construire une solide tranchée.
Au milieu de la nuit tout le 3ème bataillon est remplacé et nous retournons dans la vallée, entre Maricourt et Suzanne où nous occupons la tranchée que nous avons faite précédemment. Nous ne tardons pas à nous endormir, malgré la fraîcheur, car nous sommes écrasés de fatigue.
Nous occupons cette tranchée pendant quelques jours sans être inquiétés par l’ennemi, puis après avoir reçu un renfort du dépôt du 79ème et quelques territoriaux, le bataillon retourne en première ligne, cette fois, nous occupons la lisière du bois, pendant le jour il faut faire très attention et ne pas trop circuler, car les allemands sont terrés à quelques centaines de mètres. Seul un troupeau de vaches se promène librement d’une tranchée à l’autre. C’est ainsi qu’un matin, Holwech, un copain de l’escouade, m’apporte une pleine gamelle de lait qu’il vient de traire à deux pas de la tranchée pendant que je sommeillais. Nos vivres, préparées dans une maison encore épargnée de Maricourt, nous arrivent assez régulièrement matin et soir. Un jour notre ordinaire se trouve amélioré, un jour un veau qui était blessé par un éclat d’obus, a été achevé par nos cuisiniers. Nous passons quatre jours en première ligne sans trop souffrir, pendant la nuit nous faisons des patrouilles et installons des petits postes en avant, le jour chacun reste dans la tranchée qui est bombardée par intervalle mais sans dommage.
Après ce séjour en première ligne, nous retournons en réserve, toujours dans la vallée de Suzanne-Maricourt, nous y passons encore quatre jours pendant lesquels je suis à la garde du drapeau avec trois autres soldats de première classe. Encore une fois après un léger repos, si l’on peut dire ainsi, nous retournons occuper nos premières lignes. Cette fois, le froid se fait sentir, les nuits, qui jusqu’à présent avaient été supportables, commencent à devenir fraîches. Ce sont les premiers symptômes de la mauvaise saison, et il est à craindre malheureusement que nous aurons encore plus à souffrir pendant l’hiver, car la guerre ne semble pas devoir se terminer si vite.
Au bout de quelques jours d’occupation de première ligne, le bruit court que nous allons être relevés incessamment et parait-il, pour quitter le secteur. Le sixième jour au soir, nous sommes attaqués brusquement, fusillade, canonnade, tout s’en mêle, avec cela il fait noir. Nous répondons avec nos fusils, tirant pendant une demi-heure un peu au hasard. Puis peu à peu le calme revient. Enfin vers la moitié de la nuit, des troupes de l’infanterie coloniale viennent prendre nos positions. Pendant la relève, nous recevons plusieurs obus, j’ai ma gamelle, portée sur le sac, percée par un éclat. Nous gagnons ensuite Suzanne où nous prenons quelques heures de repos.
23 octobre 1914
Le lendemain matin, avant le jour, nous sommes réapprovisionnés en cartouches puis nous quittons Suzanne pour partir vers l’arrière. Pendant plusieurs heures nous marchons puis, tout à coup nous arrivons sur un convoi de camions automobiles qui nous attend, nous y prenons place et aussitôt installés, nous voilà partis vers un nouveau secteur. Dans l’après-midi nous arrivons à St Amand (Pas de Calais), nous y passons la nuit et un jour et sans plus tarder nous partons dès le surlendemain matin en réserve de Corps d’Armée aux environ de Souastre.
30 octobre 1914
Une fois la nuit venue, nous quittons les environs de Souastres où nous avons été tenus en réserve pendant plusieurs journées. Nous marchons pendant deux heures environ, sous la pluie, puis nous passons à Foncquevillers qui est déjà en partie démoli par les obus. Nous arrivons bientôt aux tranchées de premières lignes qui ne sont pas bien éloignées (1500 mètres) et prenons la place d’un bataillon du 69ème qui a mené là une attaque ces jours derniers et qui, depuis, occupait ces positions. La tranchée, construite depuis peu, est en bon état, chacun à une petite niche sous le parapet comme un saint dans un mur, où il peut s’asseoir. L’ennemi est tout près parait-il et il faut faire bien attention, surtout la nuit, pour éviter une attaque surprise. Pour plus de sûreté d’ailleurs, nous restons tous éveillés pendant le reste de la nuit. Le lendemain au jour, nous observons les environs et pouvons nous rendre compte en effet que l’ennemi n’est pas à plus de 300 mètres de nous. Il occupe Gommécourt et la lisière du bois qui l’entoure. Retranchés dans les maisons et surtout dans un château qui nous domine, les allemands ont là une superbe position et peuvent, sans être vus, découvrir tous nos mouvements. En avant et en arrière de notre tranchée sont étendus des soldats du 69ème tués sans doute lors de leur dernière attaque. Malgré tout nous sommes assez tranquilles, à part quelques coups de fusil et très peu d’obus dans la journée. Notre cuisine se tient à 20 minutes de marche de Foncquevillers et nous avons la soupe matin et soir, l’ennui c’est que tout est froid quand çà nous arrive et ce n’est pas ce qu’il faudrait pour passer des journées dehors en cette saison, mais il n’y a pas moyen de faire autrement.
25 octobre 1914
Voici déjà cinq jours que nous passons dans notre tranchée, c’est long et l’on ne parle pas encore quand nous serons relevés. Aussi nous nous ennuyons passablement dans ce petit coin de terre. Un petit trou où nous pouvons juste nous tenir assis sur la terre nue, sans pouvoir dormir, pendant la nuit la moitié des hommes veillent, les autres travaillent à approfondir la tranchée où des boyaux, sortes de couloirs dans la terre, qui conduisent d’une tranchée à l’autre, tout en restant à l’abri des balles.
Au dessus de notre niche, un créneau par où on surveille et l’on tire pendant la journée. Il faut surtout faire attention de ne pas laisser sa tête devant ces créneaux ou au dessus du parapet, pendant le jour, car du château en face de nous, les allemands ont facile de nous tirer dessus. C’est ainsi que plusieurs de nos prédécesseurs ont été tués.
Mais voici autre chose qui ne nous amuse pas beaucoup, il parait que d’un jour à l’autre, enfin avant d’être relevés d’ici, nous devons attaquer les tranchées d’en face et Gommécourt, une vraie forteresse, mais toutefois nous ne commencerons que lorsque d’autre régiments auront attaqués sur la gauche avec succès. En attendant, nous devons nous préparer. D’abord reconnaître exactement l’emplacement et les forces de ceux que nous avons devant nous, c’est très périlleux et ceci ne nous amuse plus. Dès lors, chaque nuit, une patrouille doit aller faire une petite reconnaissance en avant, on choisit pour cela des hommes connaissant bien l’allemand, nous avons justement plusieurs alsaciens à la section, Chapelier est du nombre de ces patrouilleurs nocturnes. Ces patrouilleurs ont touché une sorte de cuirasse en acier chromé qui doit préserver des balles, mais toutefois tirées d’une certaine distance et presque toutes les nuits, ils vont passer une heure ou deux, assez près des tranchées ennemies. C’est ainsi que plusieurs engins explosifs ont été tendus en avant de nous, de même qu’un soldat d’une compagnie voisine a traversé les lignes adverses pour aller faire sauter un dépôt de munitions. Pendant ce temps, nous ne restons pas inactifs, l’adjudant Mouillen, notre sympathique chef de section, qui est un malin ou du moins je le crois, a eu l’idée de nous faire construire, à quelques mètres de notre tranchée, une tranchée de départ peu profonde. C’est de celle-là que nous partirions pour l’attaque. Mais pour gagner cette petite tranchée, l’adjudant a eu l’ingénieuse idée de nous faire construire un couloir souterrain devant relier notre tranchée à celle nouvellement construite. Et c’est à ce travail compliqué que nous travaillons à tour de rôle, mais cela n’avance pas vite, guère plus d’un mètre par jour, car nous n’avons pas les outils convenables et nous avons plus de 40 mètres à construire. Nous n’avons pas de lumière pour travailler sous terre, puis il faut faire disparaître la terre pour ne pas faire voir à l’ennemi la préparation des travaux, sans quoi nous ne manquerions pas d’être bombardés ce qui n’a rien d’agréable. Les jours se suivent lentement et monotones, les uns travaillant sans relâche, les autres patrouillant quand l’heure est venue, mais les résultats ne donnent pas grand-chose de bon. Puis nous nous engourdissons toujours davantage dans nos trous, il a plu un peu et nous sommes crasseux, il faut voir. Un officier d’artillerie passe ses journées auprès de nous et règle le tir de sa batterie qui de temps à autre bombarde la lisière du bois. De leur côté les allemands travaillent aussi et tous les matins nous pouvons voir la terre fraîchement remuée devant nous.
28 octobre 1914
L’attaque qui devait avoir lieu à notre gauche nous est annoncée pour ce matin. En effet vers 8 heures nous entendons un court bombardement suivi bientôt d’une très vive fusillade. Nos troupes, composés de détachements de plusieurs régiments (69ème, 79ème, 37ème, chasseurs à pieds, zouaves, etc.) doivent s’emparer de Monchy, solidement défendu. Au même moment de notre côté, nous faisons des feux de salves afin de maintenir l’ennemi en arrêt devant nous. Nos travaux de terrassement ont cessé, tout à l’heure nous attaquerons à notre tour si ceux de gauche réussissent. L’heure est grave, là-bas la fusillade se poursuit avec la même ténacité. Nous ignorons ce qui s’y passe, mais dans l’après midi notre commandant apprend que l’attaque a échoué, nous avons des pertes sensibles, quant à nous nous ne bougerons pas aujourd’hui, mais plus tard on verra. Comment, est-ce possible ? Le commandement a toujours l’idée de nous lancer devant ces lignes imprenables. Nous devenons de plus en plus soucieux.
30 octobre 1914
On ne nous a plus reparlé d’attaquer et nous finissons par croire que l’idée est abandonnée. Puis comment ferions-nous maintenant, nous n’avons plus de force, voici 11 jours que nous sommes terrés dans ce coin, sans presque dormir et nourris comment, toujours froid. Auprès de notre tranchée, des cadavres qui attendent une sépulture depuis plus de 15 jours commencent à faire sentir leur présence. Mais voici que des hommes rentrant de corvée de Foncquevillers, nous annoncent que l’on parle de relève pour la nuit prochaine. Nous osons encore y croire, pensant plutôt que nous restons ici oubliés, mais la nouvelle se confirme. Pourvu que d’ici là rien ne se complique. À la nuit, nous veillons tous à notre poste, crainte d’une attaque de la part des allemands, dans la journée, des obus sont tombés tout près.
Vers minuit, nous entendons des pas. Çà y est, c’est bien la relève, qu’elle soit la bienvenue. Le temps de passer la consigne aux nouveaux camarades et sac au dos, nous descendons bien vite à Foncquevillers où se fait le rassemblement du bataillon et par une nuit froide mais claire nous regagnons Souastre où nous nous sommes arrêtés avant notre séjour en ligne. Les cantonnements sont bientôt préparés et nous ne tardons pas à nous endormir à poings fermés, tout aussi bien que si nous étions dans un bon lit. Il est 4 heures du matin.
1er novembre 1914
Il est 8 heures, le jus est prêt et un camarade le distribue pendant que nous sommes encore enroulés dans nos couvertures, le calot jusque sur les yeux et que d’une main tremblante, car nous sommes mal éveillés, nous cherchons notre quart pour recevoir le précieux café. Puis chacun s’étire peu à peu, on se frotte les yeux et l’on a de la peine à reconnaitre son voisin, tant les visages sont creusés par la fatigue, puis la terre que nous traînons sur nous. Tiens ! C’est la Toussaint dit l’un. Oui, et il parait qu’il y a la messe à 10 heures, dit un nouvel entrant.
Cela qui devait être tout naturel est pour nous un grand évènement, car depuis le 30 juillet que nous avons quitté la caserne, il n’y a plus eu pour nous ni messe, ni dimanche, nous vivons absolument comme des bêtes, c’est pourquoi nous avons été étonnés en apprenant que c’était aujourd’hui la fête de la Toussaint et surtout qu’il allait y avoir messe. (Ces jours derniers, un aumônier nous est arrivé, affecté au régiment).
Nous dormirions bien encore un peu, cela semble faire tant de bien de pouvoir s’étendre sur la paille, mais puisqu’il y a la messe, nous irons. Encore deux heures, le temps de nous décrotter, brosser, laver, raser, c’est que nous avons besoin d’un rude nettoyage. Aussi, nous ne perdons pas de temps et une heure après, nous sommes tout à fait retapés. Comme c’est bon de se retrouver propre après une si longue absence de tout soin d’hygiène.
Puis à 10 heures, nous nous rendons à l’église, en grand nombre, je vois que de la section, il n’en manque pas un. Une foule nombreuse de soldats et d’officiers du régiment est déjà arrivée, l’église est archi-comble, c’est très imposant de voir pareil rassemblement d’hommes entendre la messe. C’est notre aumônier qui officie, servit par des soldats dans leur tenue. Quel recueillement chez tous, c’est que tous ceux qui sont là ont déjà vu souvent la mort de bien près, et combien de camarades sont restés là où nous nous sommes battus. Un sermon, très touchant, arrache des larmes aux yeux de beaucoup. La musique du régiment, offre son concours et joue un air de circonstance. Tout nous transforme et nous fait énormément de bien et quand la messe fut finie nous comprenons le bonheur que nous avons eu de pouvoir y assister.
L’après-midi le travail de nettoyage a repris et nous avons revue d’armes. À 4 heures, nous mangeons la soupe et aussitôt après, nous quittons Souastre pour aller à St Amand à quelques kilomètres, où nous arrivons au cantonnement de nuit.
Nous demeurons dans ce pays jusqu’au soir du 2 novembre. Pendant ce temps, je rencontre un fils Milan de Tantonville, il est à l’escadron divisionnaire du 5ème Hussard.
Puis ce court repos passé, nous arpentons de nouveau les routes, tantôt pendant la nuit, mais souvent par la pluie. Nous apprenons qu’encore une fois nous allons changer de secteur. Où va-t-on nous conduire cette fois encore ! C’est ce que nous nous demandons.
3 novembre 1914
Nous nous sommes remis en route seulement à la tombée de la nuit pour que notre déplacement ne soit pas aperçu de l’ennemi. La pluie ne cesse pas, aussi nous barbotons dans la boue plus que nous ne voudrions. Étant arrêtés dans un pays pour une courte pose, une bonne femme vient à nous avec un seau de lait encore chaud qu’elle distribue à tous ceux qui l’entourent. Bien tard dans la nuit nous arrivons enfin à un cantonnement, nous sommes logés avec bien du mal car la place manque. Ma section a tout de même la chance de trouver un grenier rempli de gerbes et tout mouillé que nous sommes nous ne tardons pas à nous endormir car nous tombons de fatigue. Au jour nous allumons un grand feu auprès duquel nous pouvons enfin nous sécher. Nous pouvons acheter quelques provisions dans le pays, notamment du beurre.
Nous demeurons deux jours dans cette petite localité, pendant lesquels la musique du régiment nous offre un petit concert. C’est la première fois, depuis que nous avons quitté la caserne que nous entendons la musique.
6 novembre 1914
On parle sérieusement de nous conduire à nouveau dans un nouveau secteur. À 5 heures du soir, nous quittons le cantonnement pour aller embarquer à Saint Pol qui se trouve à 18 kilomètres. Nous arrivons à la gare vers 8 heures. Il ne fait pas très chaud car un brouillard épais nous environne.
En attendant que le train soit formé nous attendons jusqu’à 1 heure du matin sur le bord de la route. Enfin nous sommes conduits dans nos wagons dans lesquels nous nous installons dans l’obscurité la plus complète. Ces voitures ne sont pas du tout aménagées et nous nous y entassons pêle-mêle avec tout notre fourniment, nous nous assoyons sur notre sac. Peu de temps après le train se met en route, c’est ainsi que nous passons le reste de la nuit.
7 novembre 1914
Nous avons voyagé une partie de la nuit sans trop savoir quelle direction nous avions prise. À 5 heures et demie du matin nous débarquons à Brieulle, près de la Belgique. Nous traversons la ville qui est encore tout endormie, elle est occupée par des soldats anglais, c’est la première fois que nous voyons des alliés.
À grands pas, nous nous acheminons vers la frontière Belge que nous traversons vers 8 heures du matin. Sur notre parcours, nous croisons sans cesse des soldats anglais, ils nous offrent des cigarettes. Les soldats belges sont plutôt rares, seulement quelques officiers en automobiles et beaucoup de gendarmes.
À 11 heures, nous faisons la grande halte, nous n’avions rien touché comme nourriture depuis avant notre embarquement. Puis nous allons cantonner à Poperinghue qui se trouve à proximité, une jolie petite ville, mais où règne à ce moment un immense va et vient de soldats de toutes armes et de plusieurs nationalités.
On ne trouve plus rien à acheter dans la ville, les allemands qui en sont sortis depuis peu ont tout pillé. Nous sommes logés dans un moulin à vent et nous dormons sur le plancher.
8 novembre 1914
À 7 heures du matin nous quittons Poperinghue et marchons dans la direction d’Ypres. Nous rencontrons ainsi beaucoup de familles, femmes, enfants, qui fuient la ville que les allemands commencent à bombarder. Ces pauvres gens emportent seulement quelques bibelots sous le bras, tout le reste est laissé à la merci de l’ennemi. C’est bien triste à voir et ces belges nous voyant arriver ont l’air de nous recevoir comme des sauveurs.
Nous nous rapprochons du bruit du canon qui donne avec fracas. Nous allons faire des tranchées à proximité des troupes anglaises. Ce jour là, comme le ravitaillement ne nous arrive pas, nous tapons sur les vivres de réserve qui sont dans notre sac.
Après avoir travaillé toute la journée, nous retournons à notre cantonnement de la veille à Poperinghue.
9 novembre 1914
De bon matin, nous nous mettons en route, nous rapprochant encore du front. Nous traversons une partie de la ville d’Ypres déjà bien endommagée par la grosse artillerie ennemie. Nous pouvons voir des trous d’obus d’au moins 10 mètres de diamètre.
Partout c’est la plaine, une vaste plaine, parsemée de fermes et boqueteaux de tous côtés, sans cela, on verrait au moins à 10 kilomètres à la ronde.
À un moment donné on nous arrête à proximité d’un château important et déployé en tirailleur sur plusieurs lignes, tout le régiment se remet à nouveau à creuser des tranchées. À la nuit, alors que nous nous attendions bien à pouvoir dormir tranquilles dans les trous que nous venions de creuser, nous recevons l’ordre de mettre sac au dos et nous apprenons que nous allons occuper la ligne de feu. Les hommes du 1er bataillon doivent emporter, en plus de leur armement, des fascines, sortes de petits fagots allongés. C’est qu’ils doivent traverser un affluent de l’Yser et il n’y a pas de ponts. Ces fascines, assemblées les unes à côté des autres et jetées sur l’eau doivent servir de passerelles. Le 2ème bataillon part en réserve du 1er bataillon et le nôtre, le 3ème, allons plus à gauche, du côté de la Maison du Passeur, près du canal de l’Yser, en réserve d’un régiment d’un autre corps d’armée.
Nous voici donc partis, avançant difficilement dans l’obscurité et la pluie, allant par des chemins boueux ou à travers champs. De temps en temps, les balles arrivant jusqu’à nous, font entendre leur sifflement. Nous ne sommes plus très loin des premières lignes, nous marchons alors avec précaution et en silence.
Arrivés à un carrefour où se tiennent plusieurs fermes, on nous arrête, le commandant désigne à côté l’emplacement de chaque compagnie. Alors déployé sur une seule ligne, chaque section s’avance à l’endroit indiqué. Devant nous, toujours cette maudite plaine et à 3 ou 400 mètres, les premières lignes en contact avec celles de l’ennemi. Grâce à l’obscurité, nous avons pu arriver là sans trop de danger, mais dans quelques heures, ce sera le jour, alors nous serons vus et qu’allons-nous devenir ? Qu’allons-nous faire ? Des tranchées, c’est l’ordre que nous recevons, il faut que dans 2 ou 3 heures, chacun ait fait son trou pour pouvoir s’enterrer, puis le 1er bataillon doit attaquer à notre droite et il est fort à craindre que devant-nous, les allemands déclenchent une vive fusillade. Armés de nos outils portatifs, nous travaillons sans relâche, quoi que n’en pouvant plus et au jour, chacun est suffisamment abrité.
10, 11, 12 et 13 novembre 1914
Nous gardons notre emplacement pendant ces 4 jours. Nous ne sommes peut-être pas très à l’aise rapport à la température, vivre dans la terre en cette saison, on peut trouver plus confortable comme logement, mais ce n’est pas pour nous, pauvres soldats. Mais nous n’avons pas trop à nous plaindre de l’ennemi jusqu’à présent, pourtant il nous sait là, car chaque jour, une batterie d’artillerie règle son tir sur nous, heureusement sans nous atteindre. Les unes après les autres, les fermes qui nous environnent sont allumées par les obus incendiaires de ceux qui nous font face. La nuit, ce ne sont que d’immenses brasiers par toute la campagne. Déjà nos cuisiniers, installés dans ces maisons, ont été chassés 3 fois de place par le feu. Les voitures de ravitaillement viennent seulement à 2 ou 3 kilomètres de nous et la distribution se fait en pleine campagne.
Dans la nuit du 13 au 14 novembre, l’emplacement habituel de distribution, qui avait certainement été signalé aux allemands par quelques espions restés derrière nos lignes, fut bombardé au moment où tous les hommes de corvées étaient rassemblés autour des voitures. Les obus tombent en plein milieu de cette bande animée et font de nombreuses victimes parmi lesquelles des camarades de peloton, le sergent fourrier, le caporal fourrier, Bollenger, de Vézelise, il est enterré dans le cimetière d’Elwerdinghue, en face de l’église. Le caporal Bouchet est blessé, ainsi que d’autres hommes de la compagnie. Aussi avec la panique qui s’ensuivit, le ravitaillement en vivre n’a pas été très copieux et ce que nous avons eu de mieux à faire, ce fut de resserrer notre ceinture d’un cran, comme on dit dans le langage militaire quand on n’a rien à manger.
14 novembre 1914
Durant toute la matinée, l’ennemi se montre plus actif que ces jours derniers, les balles nous arrivent sans arrêt, les obus nous cernent de tous côtés, sûrement il va déclencher une attaque.
Vers 11 heures du matin, l’ennemi se lance en effet à l’assaut de nos premières lignes tenant en plusieurs endroits l’autre rive du canal de l’Yser. Débordées par le nombre, nos troupes se voient obligées de se replier et repassent comme elles peuvent le canal, suivies de près par les allemands. Ces derniers nous sont signalés et nous recevons l’ordre de nous porter en avant pour protéger la retraite des nôtres. Le caporal de mon escouade, Verlé, vient d’être appelé auprès du capitaine pour remplacer le fourrier tué la nuit dernière, je reçois alors le commandement de mon escouade pour partir à l’attaque. Nous devons nous porter rapidement à un groupe de maisons près du canal à 1500 mètres en avant de nous, car il doit y avoir une passerelle.
Les fusils chargés et armés de la baïonnette nous nous lançons aussi vite que nous pouvons, mais presque aussitôt une violente fusillade dirigée sur nous, fait de nombreux vides dans nos rangs. De plus, d’une fenêtre d’une maison, protégée par le drapeau de la Croix-Rouge, les allemands ont braqué sur nous une mitrailleuse.
Malgré cela nous ne nous arrêtons pas et marchons vers une meule de gerbes qui est notre point de ralliement. Nous nous massons derrière pour nous abriter des balles et reprendre haleine avant d’aller plus loin, mais à peine y sommes nous que voici à présent les obus qui nous arrivent en plein sur nous, c’est par rafales de quatre qu’ils tombent sur la compagnie. Au milieu des éclatements, on entend les cris des blessés et des mourants. La position n’est plus tenable une seconde de plus, d’ailleurs il n’y a pas moyen de défendre le passage du canal, les allemands sont de ce côté en plus grand nombre que nous, ils sont embusqués dans les maisons tandis que nous allons nous trouver à découvert. Le capitaine nous fait revenir sur nos pas et nous envoie occuper une tranchée préparée par nous la veille en cas de repli des 1ères lignes. Les balles et les obus nous poursuivent toujours, à chaque pas, c’est un nouveau camarade qui est touché plus ou moins grièvement, l’adjudant Mouillen, notre chef de section est bien touché pour sa part, un éclat d’obus le prenant par derrière, fracasse la gamelle qui est sur son sac et le blesse à la tête, des camarades l’emportent au poste de secours. Heureusement, nous arrivons à la tranchée de soutient où nous sommes un peu plus à l’abri des balles.
Peu à peu, l’ennemi se calme en même temps que le jour baisse. La nuit venue, le bataillon part remplacer les troupes des 1ères lignes. C’est une relève très dangereuse que nous avons à faire, car nous devons aller occuper des tranchées qui ne sont pas à plus de 30 mètres de celles de l’ennemi. Il pleut et fait une nuit noire à ne pas voir à 2 pas de soi, nous nous tenons les uns aux autres pour ne pas nous perdre, nous n’avançons que lentement et avec beaucoup de peine. La lueur d’un coup de fusil, une balle claque près de nous, cela annonce que l’endroit n’est pas très sûr. Voici les tranchées que nous devinons plutôt que nous ne voyons, à 2 pas c’est le canal et de l’autre côté, le tranchées adverses. On nous arrête pendant que les officiers vont prendre connaissance des consignes et en attendant que la place soit évacuée, nous nous couchons dans la boue pour plus de sécurité. A tour de rôle, les compagnies prennent contact avec leur nouvel emplacement, nous sommes les derniers placés, mais voici qu’il n’y a plus de place pour nous, chose rare. Le commandant renvoie notre compagnie à la tranchée de réserve que nous occupions auparavant. Nous reprenons donc le même chemin que nous avions suivi tout à l’heure, mais en sens inverse et pas fâchés de quitter cette position qui ne nous semblait pas trop rassurante.
Nous occupons notre tranchée des premiers jours jusque dans la nuit du 16 au 17 novembre, nous occupant, pendant la nuit, du ravitaillement en vivre et en munitions, des compagnies qui sont en 1ère ligne.
17 novembre 1914

Là, nous arrive un détachement en renfort, la plupart sont des anciens du régiment qui ont déjà été blessés au début de la guerre et qui réapparaissent sur le front. Les autres qui y arrivent pour la première fois n’ont pas l’air trop rassuré en voyant notre mine terreuse.
Pendant notre halte, nous avons la visite du Général Balfourier commandant du 20ème Corps ; il cause avec nous en vrai père de famille. A la nuit, nous nous dirigeons vers un cantonnement, à Woëstenn, joli petit bourg. Nous sommes logés misérablement dans un grenier sous les tuiles, sans paille, couchant sur un plancher. Aussi, en cette saison il n’y fait pas très chaud. Cependant, les habitants sont très hospitaliers, ils nous permettent de venir nous chauffer auprès de leur feu et le plus souvent ils se gênent beaucoup pour nous être agréable.
Le ravitaillement civil s’y fait déjà difficilement. Certaine denrée manquent. On trouve dans les débits de la mauvaise bière, du café sans sucre, et c’est tout. Aussi, c’est le pays des porcs, quand une tête de cochon se trouve suspendue au dessus d’une porte, cela indique qu’il y a de la charcuterie. Pour varier avec la cuisine de l’ordinaire, nous nous payons, une côtelette, un boc de bière, une tasse de jus, nous en sommes quitte pour 12 ou 14 sous, quelques fois même il y a un plat de frites, ce n’est pas cher.
21 novembre 1914
Depuis le 17 au soir, nous sommes cantonnés à Woëstenn. Ce petit repos fait énormément de bien, d’abord nous avons pu nous approprier ce qui est important. Malheureusement il fait froid, nous grelottons dans notre grenier sous les tuiles. J’ai réussi à me procurer une poignée de paille pour m’isoler un peu du plancher, mais qu’est ce que c’est que cela. Dans la journée, quand nous sommes libres, nous nous chauffons chez les civils qui sont bien bons pour nous, quoi que la plus grande partie ne sache pas le français. Nous avons eu concert par la musique du régiment presque tout l’après-midi et tous les soirs, il y avait Salut à l’église du pays. L’assistance y est à chaque fois bien nombreuse.

Pendant les journées du 19 et 20, nous travaillons à faire des tranchées de défense aux environs de Woëstenn, ce travail ne nous déplait pas après tous ces mauvais jours en 1ère ligne. Le bruit circule même que notre division, déjà bien éprouvée va passer ainsi quelques temps à l’arrière pour aider le géni dans ses travaux, mais hélas ! Ce n’était qu’une fausse nouvelle et le 21 au soir nous recevons l’ordre de remonter en ligne.
Pendant ces derniers jours de repos, j’ai eu le plaisir de voir Emile Humbert passant justement devant mon cantonnement avec sa compagnie revenant des 1ères lignes.
Il allait loger aux environs de Woëtenn et je suis allé le retrouver un soir.
22 novembre 1914
Voici donc notre trop court repos terminé et encore une fois, par une nuit froide, car il gèle terriblement, nous regagnons les 1ères lignes. Nous nous demandons comment nous allons supporter cette vigoureuse température, passer les jours et les nuits en plein air, sans avoir la liberté de nous remuer à notre aise pour nous réchauffer, mais nous n’avons pas le droit de penser à cela, il y a en ce moment des camarades à remplacer, voilà tout. Nous marchons donc dans la nuit et en silence, la bise nous glace la figure. Devant nous, depuis un certain temps déjà, nous voyons comme la lueur d’un incendie, grossissant à mesure que nous nous approchons et prenant finalement des proportions épouvantables, c’est encore une prouesse des allemands, car ils se plaisent à tout détruire.
Nous approchons maintenant du sinistre en même temps que nous pénétrons dans une ville bien éprouvée par de récents combats, c’est Ypres, c’est un immense brasier, se sont ses superbes halles qui se consument.
Fin du carnet.
Septembre 1914 Bataille de Capy (Somme) (Sur un feuillet à part)
Récit de G. Combes, sergent au 3ème bataillon du 79ème RI
Après avoir marché toute une nuit sans trêve,
Pour la division c’est toujours « marche ou crève »
Nous arrivons enfin au lever du soleil
Qui commence à paraître à l’horizon vermeil
A moins d’un kilomètre du champ de bataille.
Derrière les coteaux ont entend la mitraille
Ouvrant avec fracas son concert infernal
« C’est à vous de donner » a dit le général
Sitôt, le colonel par ordres et pas par signes
Fait d’abord déployer un bataillon en lignes
Puis un deuxième suit, et tout le régiment
Sauf un peu de réserve est tout en dépliement.
Il a fallu d’abord traverser le village
Que de chass-bis blessés, le regard plein de rage
Sillonnent revenant de la ligne de feu.
« Allez-y les copains, là-haut çà chauffe un peu,
L’ouvrage est avancé, vous n’avez qu’à en mettre,
Vous devez les avoir de plusieurs kilomètres ».
Nous voici donc là-haut en plein sur le plateau,
On a du cœur au ventre, il fait sec, il fait beau
Et le champ de bataille est grandiose et superbe.
Au détour du chemin, une meule de gerbes
Semble à peu près le point central du mouvement
Alors par section et successivement
Débouchant des vieux murs d’une briqueterie
Nous sautons brusquement sous la mousqueterie
Qui donne de partout avec intensité.
[2] Il s’agit du Commandant Perrenot
[3] Un des enfants de la famille Tourtel, brasseur à Tantonville
[4] Il devrait s’agir de voitures de foin, dont les grandes roues à rayons devaient rehausser le niveau du plancher suffisamment pour permettre le passage de colonne de soldats.
[5] Écrit Léhaumont
[6] Aucune mention dans les fiches de « Mort pour la France ».
[7]Si cet Etienne a survécu à sa blessure, il pourrait être question du 2ème classe Etienne marie Albert, mort le 3 octobre 1914 à la bataille de Maricourt (80)
[8] Aucune mention dans les fiches de « Mort pour la France ». Il y a 3 autres Richard, mais les dates ne correspondent pas.
[9] Il était de Gerbécourt, 2ème classe au 69ème RI. Il a été tué le 20 août 1918 Bieuxy (02) « Mort pour la France ».
[10] Le frère de Xavier Nicolle
[11] Fontenoy sur Moselle
[12] Parmi les 3 Durand « Mort pour la France » figure Durand Henry Sébastien, seul des 3 étant 1ère classe, mort le 9 mai 1915 à Neuville Saint Vaast (62), originaire de Mirecourt.
[13] Terme argotique pour désigner l’ensemble du barda de forme carré que portait le fantassin.
[14] Pétin, Victor-Eugène-Lucien-Gabriel.
Né à Bordeaux, le 17 juin 1872-Décédé à Haironville (Meuse), le 20 juin 1962.
Marié à Thérèse-Marie-Pauline Robert de Massy le 20 octobre 1904.
Entré à l’École spéciale militaire de Saint-Cyr le 21 octobre 1891, Victor Pétin en sort deux années plus tard 100e sur 449 élèves. Nommé sous-lieutenant le 1er octobre 1893, il est affecté au 7e bataillon de chasseurs à pied à Nice. « Assidu à toutes les taches qu’on lui confie, très séduisant, très intelligent…, à l’étoffe d’un excellent officier » dit déjà de lui son chef de corps à la notation de 1894. En 1897, il demande un congé de trois mois pour partir en Bavière et en Autriche afin de se perfectionner en langue allemande. Au concours de 1900, Victor Pétin est reçu à l’École supérieure de guerre à Paris. Diplômé d’état-major avec la mention « bien » et sorti 52e sur 84, il est affecté le 31 octobre 1902 à l’état-major de la 29e division d’infanterie à Grenoble. Promu capitaine au choix le 23 septembre 1904, Victor Pétin reçoit pour affectation le 31 octobre 1904 le 20e bataillon de chasseurs à Baccarat qu’il rejoint le 31 décembre 1904.
Prenant le commandement d’une compagnie en avril 1905, le capitaine Pétin « sait obtenir beaucoup de ses subordonnées, tout en se faisant aimer d’eux » observe son chef de corps, le chef de bataillon Berthelot dans la notation de 1906. À l’issue de son temps de commandement, il est nommé le 23 juin 1907 à l’état-major du 20e corps d’armée à Nancy. Il prend une part très active dans les différents services d’état-major qui lui sont confiés et notamment dans l’élaboration du plan de mobilisation au niveau du corps d’armée au cours de l’hiver 1908-1909. De 1909 à 1910, il fait preuve de « zèle et d’assiduité à l’occasion du fonctionnement de l’école régionale d’instruction de Nancy ». Le 13 février 1910, il est détaché à l’état-major particulier du ministre de la Guerre, le général Jean-Jules Brun, à Paris.
« Le ministre apprécie tout particulièrement les services rendus par cet officier de toute première valeur » écrit le général chef de cabinet à la notation de 1910. Au cabinet, il est chargé de l’étude des questions relatives à la réforme du haut commandement et à la création du Centre des hautes études militaires. Courant 1911, il sert au 1er bureau de l’état-major de l’armée et se fait remarquer pour ses très grandes compétences en matière d’organisation. Le 5 mars 1911, le ministre de la Guerre inscrit le capitaine Pétin au tableau d’avancement. Par suite d’un imbroglio administratif qu’il supporte très dignement, il n’est promu chef de bataillon hors tour que le 28 mars 1913. Nommé successivement au commandement d’un bataillon du 79e régiment d’infanterie, le 9 juin 1913, puis du 20e bataillon de chasseurs le 23 juillet 1914, il part en campagne contre l’Allemagne le 3 août 1914 avec de nouveau un bataillon du 79e d’infanterie.
Promu lieutenant-colonel à titre temporaire le 10 octobre 1914 (et à titre définitif le 2 juillet 1915), il prend officiellement le commandement du 79e, qu’il commande de fait depuis le 29 août. Victor Pétin, « chef de corps remarquable au 79e régiment d’infanterie a donné toute la mesure de ses hautes qualités militaires personnelles et de ses hautes qualités militaires personnelles et de la confiance qu’il a su inspirer à son régiment en enlevant dans une offensive superbe plusieurs lignes ennemies très fortement retranchées ». Le 13 novembre 1915, il est affecté en position hors-cadre au 3e bureau du Grand Quartier général. Il y rédige de nombreux règlements et assure les fonctions d’officier de liaison. Le 22 septembre 1916, il rejoint la mission militaire française en Roumanie. Promu colonel le 31 décembre 1916, après seulement un an et demi de grade de lieutenant-colonel, puis au grade de général de brigade à titre fictif le 6 février 1918, il prend une large part au cours de l’année 1917 comme chef d’état-major de la mission à la réorganisation de l’armée roumaine. « A été la cheville ouvrière de la mission dans tout le travail de réorganisation de l’armée roumaine » dit de lui le général Berthelot, chef de la mission. Le 9 mars 1918, il quitte la Roumanie. http://rha.revues.org/index6022.html
[15] Il s’agit de Marc Nicolle le frère de Xavier. En photo dans les tranchée de 1ère ligne en Champagne 1917


